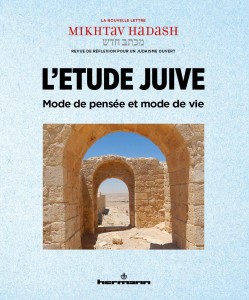La loi votée le 10 mai 2001 par le Sénat des Pays-Bas , légalise l’euthanasie sous trois conditions : 1) que le patient soit atteint d’une affection incurable ; 2) que la souffrance qu’il endure soit jugée insoutenable ; 3) que le patient ait exprimé son désir, « par une demande volontaire et réfléchie » que soit mis fin à ses jours.
[*Le terme euthanasie désigne le fait de donner une « belle mort » à une personne qui autrement, souffrirait trop de sa vie ou de son agonie.*] On sait les dérives nazies auxquelles de telles considérations ont donné lieu. La loi néerlandaise n’autorise pas indistinctement l’euthanasie mais ce qu’il convient plutôt de qualifier de « suicide (médicalement) assisté », puisque la volonté du mourrant doit être explicite.
[*Pour être plus éthique, un tel geste est-il pour autant acceptable au regard de la Tradition juive ? Il ne fait aucun doute que la réponse dépend de la manière de concilier deux impératifs fondamentaux du judaïsme qui, dans la situation qui nous occupe, entrent en contradiction : le devoir d’alléger au mieux les souffrances et celui de préserver la vie.*]
De prime abord, il paraît évident que le judaïsme privilégie systématiquement la sacralité de la vie. En effet, toute atteinte indue au corps, et a fortiori à la vie, est ipso facto considérée comme une atteinte à la souveraineté divine. De nombreux enseignements sous-tendent l’idée que Dieu demeure le seul propriétaire du monde et de tout ce qu’il contient. [*Le corps, mais aussi l’âme, ne sont mis à disposition de l’homme qu’en tant que location. Si bien que chacun est maître chez soi mais pas libre pour autant de détruire ce qui lui a été confié.*] Le suicide est donc un meurtre, et ce n’est que post facto, que les rabbins auront considéré dans de nombreux cas que la personne qui s’est suicidée aura été plus victime (de son désespoir) que coupable. Ajoutons à cette considération le fait que la sacralité de la vie est telle qu’elle demeure entière jusqu’à la fin. Autrement dit, la vie de l’agonisant doit être préservée indépendamment du temps qu’il lui reste à vivre (Choulhan âroukh, O. h. § 339). C’est pourquoi il sera interdit de déplacer son corps, pour des besoins externes aux siens, au risque d’abréger fut-ce un seul instant son existence (cf. Semahot 1).
À partir de là, il est clair que toute incitation au suicide, toute euthanasie active qui consisterait à vouloir abréger la vie, que ce soit directement (par exemple, par injection d’une substance à dose létale) ou indirectement, en fournissant au patient les moyens de mettre fin à ses jours, même au motif d’abréger ses souffrances, est strictement prohibée.
[*Toutefois, pour la Tradition juive elle-même, on ne saurait ignorer l’avilissement, la torture indescriptible que peuvent parfois éprouver des agonisants en phase terminale. Y être indifférent, au prétexte de la sacralité de la vie, confinerait au sadisme.*] Il est vrai que le fait de souffrir même durement n’est pas en soi une raison de se donner la mort. Pour le judaïsme, la souffrance n’est pas vaine car elle incite à dépasser la suffisance (morale). Elle influe sur la qualité spirituelle de notre existence en nous faisant mieux connaître le prix des choses, en nous rendant plus sensible à celle des autres, et à nous mobiliser pour l’apaiser. Mais il y a un seuil à partir duquel la souffrance elle-même n’est plus « vivable » ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement.
Ce qui est clair par-dessus tout, c’est que la souffrance ne doit jamais être recherchée pour elle-même, même si elle comporte une dimension rédemptrice.
Une aggada célèbre relate le cas de plusieurs maîtres qui étaient tombés malades et qui tous réagirent comme R. Hiya bar Abba auquel R. Yohanan rendit visite. Celui-ci lui demanda : « Tes souffrances te sont-elles appréciables ? » R. Hiya lui répondit : « Ni elles, ni la félicité qu’elles peuvent procurer » (Berakhot 5b).
[*La souffrance a un prix dont tout esprit sain, et saint, se passerait volontiers.*] À plusieurs reprises, les sources talmudiques rapportent que des prières ont été entendues par le Ciel pour que s’éteigne une personne aimée en proie à d’atroces souffrances physiques ou mentales. Ce fut le cas pour Rabbi (Ketoubot 104a) et pour R. Yohanan (Baba Metsia 84a). Il est également fait état du désir de mourir exprimé par une personne en bout de course du vieillissement, et exaucé par Dieu, sur le conseil d’un rabbin (cf. Yalkout Chimôni, Michlé § 943).
Mais précisons le bien : ce n’est qu’au seuil ultime de la vie, quand elle n’est plus du tout ni digne ni supportable pour la personne elle-même, que la précipitation de la mort peut être souhaitée et souhaitable. Mais il faut se montrer extrêmement circonspect car il arrive qu’un malade subissant d’insoutenables douleurs réclame la mort, mais qui lorsqu’il connaît une rémission, ne réitère plus sa requête.
Comment dès lors concilier la sacralité du moindre instant de vie avec la compassion envers le mourrant qui demande à abréger ses souffrances ? Deux sources ont permis à certains décisionnaires d’en induire une conduite à suivre.
La première se rapporte au martyre de R. Hanania ben Tradion, supplicié par les Romains pour avoir enseigné la Tora. Alors qu’il brûlait sur le bûcher, le corps enroulé d’un rouleau de la Tora, ses disciples horrifiés lui suggérèrent d’ouvrir la bouche pour mourir plus rapidement. R. Hanania s’y refusa au motif explicite que ce soit Dieu seul qui prenne son âme. Mais quand le bourreau lui demanda s’il aurait un mérite à augmenter les flammes et à retirer de son torse les laines humides qui avaient été disposées pour prolonger son agonie, il acquiesça (Avoda zara 18a). [*On en a tiré la distinction entre une euthanasie active qui consiste à (se) donner délibérément la mort, et une euthanasie passive qui consiste à lever les obstacles qui ralentissent l’agonie d’une mort imminente.*] Le fait que le bourreau ait augmenté les flammes, geste qui génériquement s’apparente à une euthanasie active, n’a pas été considéré comme tel ici dans la mesure où le cadre est celui d’une exécution capitale en cours, et que le bourreau n’avait d’autre mérite que d’accélérer la venue de la mort .
[1]
La seconde source est sur ce point plus explicite. Le Sefer ha-Hassidim (XIIIe s.) stipule que si un fendeur coupe du bois à proximité d’un mourant, et du fait de ce bruit, l’empêche de se détendre et de s’éteindre, on doit l’en empêcher. On ne peut pas non plus mettre du sel sur la langue de l’agonisant, pour le faire réagir et retarder ainsi son décès (§ 723, éd. Margaliot). [*C’est là, indirectement, une condamnation de ce qu’on appelle aujourd’hui « l’acharnement thérapeutique », mais aussi l’acceptation de l’euthanasie passive qui écarte toute obstruction à l’extinction naturelle.
*]
Grâce aux progrès de la médecine palliative, il est désormais possible aujourd’hui de mieux vivre sa fin de vie, et telle est la bonne démarche qui doit être privilégiée aux dépens de toute euthanasie. Dans les cas les plus extrêmes, certains décisionnaires envisagent d’avoir recours à l’euthanasie passive qui consiste à suspendre tous les soins maintenant artificiellement en vie . [2]
On notera pour finir la position audacieuse du rabbin Dorff qui consent au pire de l’état du patient à une euthanasie active, pour autant qu’elle soit seulement subséquente au soin analgésique. Si donc, le but premier n’est pas de donner directement et volontairement la mort mais d’administrer une dose d’analgésique calibrée pour contrer la douleur du patient, au risque connu et inévitable que l’effet secondaire soit de hâter la mort, l’acte serait légitime, voire louable . [*On marche ici sur la ligne de crête à la frontière de l’acceptable. Mais la nuance éthique est de poids : jusqu’au bout, le seul objectif digne doit être l’allégement de la souffrance dans le respect maximal de la sacralité, mais aussi de la dignité, de la vie.*]