1995 -Une émission de télévision aujourd’hui disparue : “La Marche du Siècle”. Un vieil homme, Joseph Weismann, témoigne. Soudain, sa voix se brise. “Si quelqu’un ose un jour faire un film sur ce qui nous est arrivé...” Puis il se reprend. “Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que quelqu’un osera un jour”....
2010 -Sortie du film sur la Rafle du Vel d’Hiv. Du point de vue de Joseph Weismann, qui avait dix ans à l’époque. Tous les personnages du film ont existé. Tous les évènements sont fidèlement reconstitués.
Jusqu’ici, aucun film n’avait traité exclusivement de l’un des événements les plus dramatiques de l’Occupation : la rafle du Vel d’Hiv’, le 16 juillet 1942.
L’arrestation de plus de 13 000 hommes, femmes, enfants, vieillards, par les autorités nazies et françaises avait servi de toile de fond à de nombreux films (parfois avec inexactitude : ainsi Monsieur Klein de Joseph Losey situe la rafle en hiver…), mais La Rafle de Rose Bosch s’attaque de front à ce drame avec une nette volonté de tout dire et de s’en tenir aux faits.
C’est à notre avis un film qui ne manque pas de vertus et qui a le grand mérite de tendre à la France un miroir qui était et est encore nécessaire.
Bonne critique
Il n’était que temps. Presque soixante-dix ans après la rafle du Vél’d’Hiv, le 16 juillet 1942, voici qu’on découvre, sur l’écran, ce qu’a été cette abjection. 9 000 policiers français ont participé à ce coup de filet qui a permis de livrer 13 000 juifs, dont des milliers d’enfants, aux nazis. Envoyés à Auschwitz, seuls 25 adultes en réchapperont. Rose Bosch, scénariste de "1492" et réalisatrice d’"Animal", s’est attaquée avec courage à ce point aveugle de l’Histoire de France. Très solidement documenté, interprété avec ferveur par Jean Reno, Gad Elmaleh et Mélanie Laurent, le film retrace l’arrestation, l’internement et la déportation des juifs à Paris. La qualité d’émotion est extraordinaire : impossible de rester insensible au spectacle de cette honte. Pourquoi sommes-nous si lents à examiner les zones sombres de notre Histoire ? "La Rafle" est un film qui fait honneur au cinéma français.
François Forestier (Nouvel Obs)
Critique mitigée
Le 16 juillet 1942 à Paris, sous l’occupation allemande, la police française arrête 13 000 juifs à leur domicile - hommes, femmes, enfants - et parque les familles dans le Vélodrome d’Hiver, dans le 15e arrondissement.
Transférées dans divers camps de transit du Loiret, elles sont déportées à Auschwitz. Vingt-cinq personnes reviendront, aucun des quelque 4 000 enfants.
C’est cet épisode de la déportation des juifs de France (70 000 d’entre eux ont été exterminés), tribut de l’Etat collaborationniste à l’entreprise génocidaire nazie, qui fait l’objet de ce film.
Celui-ci privilégie trois moments : la rafle proprement dite, filmée dans un Montmartre pimpant ; les journées passées dans le Vél’d’Hiv reconstitué ; le séjour dans le camp de Beaune-la-Rolande, jusqu’au départ vers l’est. On suit dans ce parcours vers la mort, parmi une masse de figurants, des personnages par les yeux desquels l’événement est vécu. La famille Weismann, dont le fils parviendra à s’évader de Beaune. Le docteur Sheinbaum, qui se dévoue corps et âme, l’infirmière Annette Monod qui restera auprès des enfants jusqu’à leur départ, et d’autres encore.
Le film se veut présent à la fois sur la scène des causes (discussions entre Pétain et Laval, négociations entre police française et Gestapo, Hitler buvant un schnaps dans son nid d’aigle...), et sur celle des effets. Il recourt au plan d’ensemble surplombant (le Vél’d’Hiv surpeuplé), comme aux effets de caméra embarquée (scènes d’effroi, de bousculade). Il multiplie les détails vrais comme autant de gages à la complexité du réel.
Il convient de noter que La Rafle sort à la suite d’une campagne de promotion qui met en avant un scrupuleux travail de documentation (Serge Klarsfeld en a été le conseiller historique), l’ambition pédagogique et morale dont se prévalent ses auteurs (Rose Bosch, la réalisatrice, mais aussi son producteur et mari Ilan Goldman), et le caractère inédit de la représentation de cet événement. Tout cela fait peser sur sa réception critique une lourde hypothèque, confinant toute réserve au rejet d’une juste cause.
Deux choses doivent pourtant être dites. La première, factuelle, est que, contrairement à ce que martèle la campagne en cours, La Rafle ne nous apprend rien de fondamental sur l’événement. Sa divulgation historique, sa commémoration publique, son enseignement à l’école, son évocation par de nombreuses oeuvres de l’esprit, qu’il s’agisse de littérature ou de cinéma, le prouvent.
La seconde est que ce film est médiocre sur le plan esthétique. La principale raison tient à son ambition spectaculaire, à l’impression qu’il veut donner "d’y être". Le pathos et le manque de recul ne sont pas seuls en cause. Beaucoup de choses y sonnent aussi désespérément faux. Tel accent yiddish est sans conteste un accent, mais pas yiddish. Hitler est certes reconnaissable, mais l’acteur grimé qui l’interprète est peu crédible. Tout le monde reconnaît l’humoriste Gad Elmaleh sous sa défroque de petit artisan juif trotskyste, et s’intéresse malheureusement davantage à sa composition qu’au personnage qu’il incarne. Ce ne sont que quelques exemples.
Ces dissonances traduisent une faiblesse de conception qui empêche la réalisatrice de voir que la déréliction et le grand spectacle ne font pas bon ménage, que la justesse des personnages, des situations et des sentiments n’est pas conditionnée par la multiplicité de détails de reconstitution. Faute de pouvoir être réellement partagées, certaines expériences existentielles ruinent cette convention réaliste.
A contrario, c’est bien la reconnaissance de la difficulté de ce partage qui est garante du respect dû aux victimes. Aussi n’est-ce pas la sincérité du film qui est ici en cause, mais la naïveté avec laquelle il fait croire qu’il pourrait tout montrer. Certains événements conservent une part d’opacité irréductible qui les soustrait à une telle transparence. En l’ignorant, l’art, comme impératif de transmission, trahit sa vocation.
Jacques Mandelbaum
Paru dans Le Monde du 10.03.10
Mauvaise critique
La Rafle est une initiative du producteur à succès Ilan Goldman (les Rivières pourpres, l’Enquête corse, la Môme…) qui, comme il l’explique dans le dossier de presse, est issu « de cette communauté de Juifs de Montmartre qui a beaucoup souffert », notamment ces fameux 16 et 17 juillet 1942, qui virent quelque 4 000 policiers français rafler 13 000 personnes (femmes, vieillards et enfants compris), transportées par bus (cars de police et bus publics de la TCRP, ancêtre de la RATP) dans l’enceinte du Vélodrome d’Hiver, édifice sportif du XVe arrondissement parisien détruit en 1959. Ils y resteront cinq jours dans des conditions d’hygiène déplorables, avant d’être expédiés dans divers camps français (Drancy, Beaune-la-Rolande, Pithiviers). Ils seront ensuite déportés par train vers les camps de la mort en Pologne.
Ilan Goldman a confié le soin de réaliser ce projet hautement sensible à son épouse, Rose Bosch, ancienne journaliste, scénariste (notamment de Bimboland, d’Ariel Zeitoun, en 1998). Quelque 20 millions d’euros de budget, un casting populaire (Jean Reno, Gad Elmaleh, Mélanie Laurent, Sylvie Testud…), une reconstitution des événements supervisée par Serge Klarsfeld et reposant, selon Rose Bosch, sur trois ans de travail de documentation préparatoire.
Scène factice. Le film s’ouvre par des images d’archives de Hitler visitant un Paris désert après l’invasion, puis un panneau indique au spectateur : « Tous les personnages du film ont existé. Tous les événements, même les plus extrêmes, ont eu lieu cet été 1942. » La formule est pour le moins étrange, s’agissant d’un film qui traite d’un fait historique d’une telle gravité et dont personne ne discute le caractère de honte nationale, devenu officielle depuis le discours de Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, où il était question de « faute collective » : « La France, patrie des Lumières et des droits de l’homme, terre d’accueil et d’asile, la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. »
Partant de la constatation qu’il n’existe pas d’images de la rafle (peu de photos, pas de film d’actualité), orchestrée dans le plus grand secret par Pétain, Laval et Bousquet, le film travaille à remplir ce vide de la représentation. Mais on essaie ici d’associer trop d’éléments inconciliables : la recherche de la vérité historique et les ressorts mélodramatiques du récit, l’hommage sincère à la mémoire des morts et le fracas spectaculaire de la fresque avec figurants en nombre (« On a eu plus de 10 000 cachets de figuration, presque le nombre de raflés » dixit Ilan Goldman), cris, larmes, envolées majestueuses de la caméra embrassant le théâtre des opérations… la Rafle n’est pas un bon film et il n’est pas la vérité. Il construit une scène factice sur laquelle est rejoué un drame véridique, c’est différent.
« L’image vraie du passé passe en un éclair. On ne peut retenir le passé que dans une image qui surgit et s’évanouit pour toujours à l’instant même où elle s’offre à la connaissance », écrivait Walter Benjamin, qui prônait un historicisme matérialiste lavé de toute « empathie ». Or la démarche du film est inverse, nulle trace du présent de l’époque, mais le kitch habituel du film en costume français. Il faut tout montrer, tout rejouer, les mères qui hurlent, les enfants pataugeant dans la merde. L’image absente devient, par glissement sémantique et moral, une image manquante qu’il faut à tout prix créer de toutes pièces si l’on veut perpétuer le devoir de mémoire. Méthode qu’il est au moins possible de contester. Il y a pourtant une figure intéressante à travers le cas (sourcé à partir des entretiens qu’elle accorda à la radio et à la télé avant sa mort en 2005) d’Annette Monod, infirmière protestante (interprétée par Mélanie Laurent), qui soigne les raflés et se trouve prise au piège d’un système gouvernemental qui lui accorde le droit d’humaniser l’horreur mais pas d’en arrêter le cours.
Mantra. On peut enfin s’étonner de la capacité de mobilisation de troupes au sein de l’éducation nationale pour ce genre de grosses productions à lourds sujets. La Rafle a été montré en avant-première dans 27 salles à travers la France pour les professeurs, un document pédagogique a été envoyé à 11 000 collèges et lycées. Il est pour le moins troublant de trouver sur plusieurs sites liés à l’éducation nationale un texte de présentation vantant les mérites du film avec ce mantra autojustificatif qui émane directement de la production : « Tous les personnages du film ont existé, tous les événements ont bien eu lieu. » Apprendre à penser dans de telles conditions risque de devenir difficile.
Par DIDIER PÉRON
Dans Libé du 10/03/2010
Les faits historiques
En deux jours, plus de douze mille Juifs, dont 4.000 enfants, furent arrêtés à Paris et en banlieue. Cette opération avait pour nom de code « Vent printanier ».
Depuis la promulgation par le gouvernement de Vichy du premier statut des Juifs, le 3 octobre 1940, jour de Roch Hachana, nouvel an israélite, les Juifs étaient exclus des postes d’encadrement des services publics, du corps des officiers et des sous-officiers, ainsi que des professions à responsabilités dans la presse, le cinéma et le théâtre.
Depuis le 19 octobre 1940, figurait sur leurs pièces d’identité le tampon « Juif » ou « Juive ».
Depuis le 26 avril 1941, ils n’avaient plus le droit d’exercer une activité économique. Des administrateurs provisoires « aryanisaient » leurs commerces, leurs ateliers, soit en les vendant, soit en les liquidant. Et dans la plupart des cas, se servaient allègrement dans la caisse.
Depuis le 13 août 1941, il était interdit aux Juifs de posséder un poste de TSF.
Depuis le 7 février 1942, ils ne pouvaient plus sortir entre 20 et 6 heures du matin.
Depuis le 29 mai 1942, ils étaient tenus de porter une étoile jaune.
Article 1 de l’ordonnance : « Il est interdit aux Juifs, dès l’âge de six ans révolus, de paraître en public sans porter l’étoile juive. » Article 2 : « L’étoile juive est une étoile à six pointes ayant les dimensions de la paume d’une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte, en caractères noirs, l’inscription “Juif”. Elle devra être portée bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine, solidement cousue sur le vêtement. »
De mois en mois, la situation de Juifs de la zone occupée n’avait cessé de se dégrader. Ainsi, à partir du 8 juillet, ils n’allaient plus pouvoir fréquenter les salles de spectacles, les restaurants. Même les jardins publics allaient être interdits aux enfants.
La vie au quotidien s’assombrissait. Avec, en permanence, le risque de tomber dans un piège administratif ou de se faire embarquer à un barrage de police.
Ainsi, le 14 mai 1941, près de quatre mille Juifs étrangers étaient arrêtés. La veille, un « billet vert » les avait convoqués à la mairie de leur arrondissement ou au commissariat de police de leur quartier. « Simple vérification d’identité », leur avait-on dit. En fait, internés à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers, deux camps du Loiret, ils allaient être déportés à Auschwitz quelques mois plus tard.
Le 20 août suivant, débutait la rafle dite du XIe arrondissement, qui allait durer jusqu’au 24 et s’étendre à d’autres quartiers de Paris et à la banlieue : plus de quatre mille arrestations. Des hommes âgés de dix-huit à cinquante ans, qui seront, eux aussi, déportés à Auschwitz.
Puis il y eut la circulaire n° 173-42 du 13 juillet 1942, deux jours après l’arrivée à Compiègne des premiers prisonniers de guerre français libérés au titre de la relève. Neuf pages frappées du mot « secret », adressées par la Direction de la police municipale de la Préfecture de Police, « à Messieurs les divisionnaires, commissaires de voie publique et des circonscriptions de banlieue » : « Les autorités occupantes ont décidé l’arrestation et le rassemblement d’un certain nombre de Juifs étrangers. » Sous l’intitulé « âge et sexe », ces indications sur la « mesure » qui a été prise : « Elle concerne tous les Juifs… quel que soit leur sexe, pourvu qu’ils soient âgés de seize à soixante ans (les femmes de femmes de seize à cinquante-cinq ans). »
Et cette précision : « Les enfants de moins de seize ans seront emmenés en même temps que les parents. »
La circulaire n° 173-42 soulignait par ailleurs : « Les équipes chargées des arrestations devront procéder avec le plus de rapidité possible, sans paroles inutiles et sans commentaires. En outre, au moment de l’arrestation, le bien-fondé ou le mal-fondé de celle-ci n’a pas à être discuté. »
« Les individus ou familles n’ayant pas d’enfant de moins de seize ans » devaient être conduits à la cité de la Muette, à Drancy, un ensemble encore en chantier de mille deux cents logements construit par l’Office public d’habitation à bon marché du département de la Seine, transformé depuis le 20 août 1941 en « camp de passage et d’internement », « les autres », au Vélodrome d’Hiver, dans le XVe arrondissement. Surpris dans leur sommeil, des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants, des vieillards, allaient être parqués dans ces deux lieux dans des conditions épouvantables. Nourriture insuffisante, manque de soins, pas assez de points d’eau, aucune hygiène. Des dizaines de bus de la STCRP (Société des transports en commun de la région parisienne), qui deviendra la RATP en 1948, avaient été réquisitionnées pour les y acheminer.
Au total, durant ces deux jours, 12.884 juifs, dont 5.802 femmes, 4.051 enfants et 3.031 hommes, furent raflés à Paris et en banlieue.
Témoignages
Frida Wattenberg : “Mon oncle était persuadé de pouvoir retrouver sa femme”
La veille, dans le quartier de la rue des Rosiers, dans le IVe arrondissement, le bruit avait couru qu’une rafle importante se préparait. Frida Wattenberg avait 18 ans, son frère, Maurice, 17 ans. Leur mère, Alta, qui, divorcée, élevait seule ses deux enfants, avait aussitôt décidé d’envoyer Maurice chez une amie à Freinville, près de Livry-Gargan. Quant à Frida, il n’était pas question qu’elle s’éloigne de Paris. Dans l’après-midi, elle passait le baccalauréat.
Les Wattenberg habitent au deuxième étage sur cour du 13, rue des Ecouffes. Ce 16 juillet 1942, il est « cinq ou six heures du matin » quand on frappe à la porte de leur appartement. Deux policiers. L’un en uniforme, l’autre en civil. Ils ordonnent à Alta Wattenberg de préparer un léger bagage. Ils vont repasser dans une heure. Frida ne figure pas sur leur liste. Née à Paris, elle a la nationalité française. Pas sa mère, immigrée originaire de Tomaszov-Mazowiecki, près de Lodz en Pologne. Frida confie : « J’ai dit à ma mère qu’il fallait se sauver, se cacher. Elle a refusé.
– Où irions-nous, m’a-t-elle dit ? Nous n’avons pas d’argent, pas de relations. Et puis, je n’ai rien fait de mal. »
A peine Alta s’éloigne-t-elle encadrée par les deux policiers que Frida se précipite chez son oncle Yankel. Il vit avec sa fille Rachel, rue de Lancry, dans le Xe. « Leur concierge m’a appris qu’ils avaient été embarqués et qu’ils se trouvaient, avec d’autres Juifs, à la caserne des pompiers de la rue du Château-d’Eau. Ils attendaient les bus qui les conduiraient à Drancy. Un policier était en faction à l’entrée de la caserne. J’avais une carte d’identité française, bien que barrée du tampon Juif. Il m’a laissée passer. C’était l’après-midi. J’ai vu mon oncle et ma cousine. Comme je n’avais pas été arrêtée, une femme m’a donné des tickets de rationnement afin que j’aille acheter du lait pour son bébé. J’y suis allée. Voyant que je pouvais aisément sortir et rentrer, plusieurs autres personnes m’ont demandé de leur faire quelques courses. Le policier en faction me laissait faire. Alors j’ai dit à mon oncle et à ma cousine : suivez-moi, je peux vous sortir d’ici. Mon oncle m’a répondu : – Non ! On nous a affirmé qu’on allait nous renvoyer là d’où nous sommes venus pour travailler. Nous partons travailler en Pologne. A Tomaszov-Mazowiecki, je retrouverai ma femme et mes autres enfants restés là-bas. »
L’oncle Yankel sera déporté pour Auschwitz par le convoi 33 du 16 septembre 1942. Sa fille Rachel par le convoi 12 du 29 juillet 1942.
Grâce à un document certifiant qu’elle travaille dans un atelier fabriquant des vêtements pour les Allemands, Frida fera sortir de Drancy sa mère, qui sera ensuite hébergée par un employé municipal de Lhommaizé, près de Montmorillon, dans la Vienne. Et jusqu’à la fin de la guerre, Frida se battra dans la Résistance.
Rachel Psankiewicz-Jedinak : “En me giflant, ma mère m’a sauvé la vie.”
Chana-Gitla Psankiewicz, la mère de Rachel, avait pourtant pris ses précautions.
Depuis que son mari, Abram, avait été piégé en mai 1941 par le « billet vert », elle était sur ses gardes. Or, le 15 juillet 1942, la rumeur avait couru qu’une grande rafle se préparait. Dans la soirée, elle avait envoyé ses deux filles, Rachel, 8 ans, et Louise, 13 ans, dormir chez leurs grands-parents, 15, rue de Tlemcen, dans le XXe arrondissement. Elle était restée chez elle, 26 rue Duris. C’est là qu’au petit matin, le 16, des policiers vont l’arrêter, tandis que la concierge « va signaler aux flics » que les deux gamines se trouvent chez leurs grands-parents, rue de Tlemcen.
Rachel se rappelle les coups dans la porte, les ordres, les cris, les lamentations , les groupes de Juifs rassemblés au pied des immeubles. « Comme un troupeau, les policiers nous ont guidés jusqu’à La Bellevilloise, une salle de spectacles, 23-25, rue Boyer.
Aux fenêtres, sur les trottoirs, les gens regardaient notre misérable troupe. Certains faisaient un signe de croix, les larmes aux yeux. D’autres nous montraient du doigt en rigolant. C’était humiliant de se sentir traité comme du bétail. »
A La Bellevilloise, dont les sièges ont été démontés pour dégager de la place, les deux gamines retrouvent leur mère, qui a repéré une issue de secours au fond de la salle, ainsi que leur cousin, Peysach, 16 ans. Chana-Gitla le supplie de partir. Il refuse. « Je ne suis plus un enfant. J’ai l’âge de travailler. »
Il sera déporté trois jours plus tard par le convoi 7.
Chana-Gitla tente également de convaincre ses deux filles de filer. Elles pleurent, ne veulent pas se séparer d’elle. Rachel s’accroche à la robe de sa mère. A bout d’argument, Chana-Gitla la gifle. « Ma mère ne m’avait jamais frappée. Il m’a fallu du temps pour prendre conscience qu’il s’agissait d’une immense preuve d’amour. En me giflant, m’a mère m’a sauvé la vie. »
Résignées, les fillettes vont sortir. Dehors, deux policiers en faction détournent la tête en les voyant s’éclipser. Chana-Gitla sera déportée par le convoi 12 du 29 juillet 1942.
Sur le Blog de Trigano
Non pas analyse du film mais du phénomène autour...








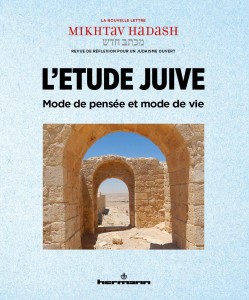


Messages
Un avis personnel : c’est un bon film. Il a le mérite de mettre en images ces moments sombres de l’histoire, à partir de témoins encore vivants. Car il n’y a pas d’images de cette rafle, même pas pes photos. Pas de longueurs, une certaine pudeur, pas trop larmoyant.
Que demander de plus d’une fiction ? Supervisée par Serge Klarsfeld, ce film restera un témpoignage pour aujourd’hui et demain.
Voici un article faisant suite à la rencontre de nos élèves du collège de Drulingen en Alsace avec Joseph Weismann, dont l’histoire a inspiré le film. Lui-même ayant beaucoup de choses à redire sur le film, je ne saurai que trop vous conseiller la lecture de son livre Après la rafle.
Voir en ligne : http://www.col-drulingen.ac-strasbo...