Il y a pratiquement dix ans, le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, assista sur la plus grande place de Tel-Aviv à un rassemblement en faveur de la paix. Il y prononça un discours où il renouvelait son engagement dans la politique de réconciliation avec les Palestiniens. En compagnie de la foule immense et entraîné par elle, il chanta l’Hymne à la paix puis la Hatikvah, l’hymne national israélien. Ces chants furent ses dernières paroles publiques. Quelques minutes plus tard, les détonations d’une arme à feu annoncèrent la tragédie : Rabin, l’acteur majeur du processus de paix, le symbole d’une nouvelle politique israélienne, était abattu.
Le meurtrier visait le processus de paix auquel il s’agissait de mettre un terme sans tarder. Non seulement il atteignait la tête de la politique d’ouverture, mais il voulait signifier que la société israélienne ne tolérerait qu’aucune « ligne rouge » soit franchie. Le meurtrier s’était visiblement chargé de transmettre ce message à destination de toute politique future. En assumant d’être arrêté, jugé et emprisonné, le meurtrier est devenu le martyr volontaire d’une politique de l’impossible. Sa mission fut de clore le processus de paix, d’imposer au monde le dernier mot de l’histoire. Or, comme le rappelle Paul Ricœur, imposer le dernier mot est la démarche même de la violence et ne peut déboucher que sur le refus de la paix.
II y a, dans la courte histoire de l’Etat d’Israël, une succession interminable de violences subies ou infligées. Les guerres conduites par les Arabes, puis par les Israéliens, les spoliations, les attentats, l’occupation des territoires palestiniens, les démolitions de maisons, les assassinats plus ou moins ciblés. Autant de derniers mots que les uns ou les autres tentent d’imposer. Autant de tentatives de renverser le cours de l’histoire. Autant de martyrs, assumés ou pas, des causes douteuses et perdues. La paix avancera cependant, malgré le meurtre de Rabin, malgré les lignes rouges proclamées infranchissables, malgré les attentats.
L’histoire du jeune Etat d’Israël est énigmatique. Succédant à ce que, de Marx à Jean-Paul Sartre, on appelait la Question juive, une sorte de question israélienne accompagne presque quotidiennement l’actualité, et cela depuis maintenant plus de cinquante ans. La somme de violence, et donc de tentatives d’imposer le dernier mot, est une des constantes de cette histoire, comme l’est également l’impossibilité de figer les résultats que cette violence obtient. Le processus de paix a été abattu à Tel-Aviv en 1995, il ressurgit à Camp David en 2000 ; Arafat est déclaré politiquement mort en 1982 lorsqu’il est contraint par la guerre de quitter le Liban, et une nouvelle fois lorsqu’il prend le parti de Saddam Hus¬sein au moment de la première Guerre du Golfe en 1991. Deux ans après, il signe les Accords d’Oslo et serre les mains du Président Clinton, du Premier ministre Rabin et du ministre des Affaires étrangères Peres. La deuxième Intifada semble enterrer la fragile trêve à nouveau, mais il y a l’Initiative de Genève, puis le plan d’évacuation de Gaza.
La question israélienne succède et se surajoute à l’ancienne question juive, la question de l’identité juive, du sens d’être juif, de l’étrangeté et de la fragilité de la condition juive, de l’insertion juive dans un monde plus ou moins hostile, de la survie du judaïsme et des Juifs. En devenant très consciemment l’Etat juif, Israël réunit sur ses épaules le poids de toutes ces questions qui explicitent la question juive de base. Peut-être est-ce cela qui explique, au moins en partie, la fascination qui perdure pour tout ce qui touche à la politique israélienne. L’identification d’Israël au judaïsme redouble toute activité politique, diplomatique, militaire en test, en examen de passage du judaïsme : voyons donc comment l’Etat juif s’en tire. Dans ces conditions, il est parfaitement vain de considérer qu’Israël est un Etat comme les autres : ses mains sont liées par la définition qu’il s’est donné lui-même. Quand Israël s’expose sur la scène internationale, c’est bien le judaïsme qui s’expose en même temps.
Par ailleurs, les événements du Proche-Orient constituent, à bien des égards, des cas d’école pour les sciences humaines. C’est particulièrement frappant en ce qui concerne l’aspect juridique du conflit. La décision récente (2004) de la Cour internationale de justice figurera désormais dans les annales du droit international, dans tous les manuels grâce auxquels les nouvelles générations de juristes internationalistes s’initieront à leur discipline. Le côté « cas d’école » de la politique israélienne ne se résume pas au seul cas du droit. Dans le domaine de la politique également, il est peu d’exemples aussi impressionnants de la présence agissante, à tous les niveaux, d’un Etat fort et interventionniste comme l’est l’Etat d’Israël, d’un Etat qui assume si pleinement la morale des « mains sales » (notamment la politique de bouclage de territoires, de destruction des maisons de civils, d’assassinats ciblés de responsables terroristes présumés) dans l’intérêt de la sécurité de ses citoyens.
En Israël, comme ailleurs dans le monde, le conflit interminable avec les peuples arabes de la région appelle très fortement un besoin de compréhension : pourquoi ce conflit ? Pourquoi cette violence ? Pourquoi ne parvient on pas à y mettre fin ? Qui a tort, qui a raison ? Quel avenir pour les peuples ? Que peut faire la communauté internationale ? Les enseignants de sciences humaines ne peuvent ignorer ces questions simples. Ils le peuvent d’autant moins que ce faisceau d’interrogations rejoint leur propre questionnement, leur propre tentative de se positionner dans la double problématique de la question juive et de la question israélienne.
Comprendre, c’est en premier lieu s’efforcer de reconstruire l’histoire, de reconstituer la genèse des événements. Comprendre la situation juridique signifie remonter à l’origine de la chaîne généalogique des décisions des instances compétentes en droit international ; comprendre l’ethos israélien suppose de reconstruire les sortes de couches de l’imaginaire sioniste qui se sont superposées les unes aux autres ; comprendre la relation à l’autre veut dire explorer et analyser des situations d’interface où l’autre est présent.
Comprendre, c’est aussi faire droit à la complexité et à l’ambiguïté fondamentale des situations, ce qu’Ariella Azoulay et Adi Ophir appellent le caractère hybride, le fait qu’une situation appelle des interprétations divergentes qui doivent se confronter, interagir dans des jeux de simulation, dans des pourparlers et des négociations, sans que l’une ou l’autre partie n’impose sa propre interprétation comme dernier mot générateur de violence et de blocage. Les situations sont toujours hybrides, les politiques ont toujours, comme on essaiera de le montrer, un endroit et un envers. Si l’on veut échapper à l’inconfort de cette situation, il n’y a probablement que deux voies : la voie basse, meurtrière, celle de la violence qui impose son dernier mot ; ou la voie haute, d’un accord, d’un langage commun trouvé au terme d’un travail entrepris entre les parties, comme l’Initiative de Genève a pu en donner un exemple frappant. Le droit, celui que les parties au conflit et la communauté internationale construisent, est ce langage commun minimal.
Les « lignes rouges » sont les interdits que les opinions publiques et les gouvernants posent dans une négociation : interdiction d’aborder tel ou tel point, de transiger sur tel autre. Et pourtant l’histoire n’avance qu’en renversant les vérités éternelles, qu’en déconstruisant les dogmes et les certitudes. Comment, autrement, le mur de Berlin aurait-il pu tomber ? Comment l’apartheid sud-africain aurait-il pu être démantelé ? Comment, sans cela, aurait on pu envisager d’évacuer la bande de Gaza ?
L’un des effets de la mondialisation est qu’il n’y a plus de chasses gardées nationales, de problèmes politiques où l’étranger n’a rien à voir, rien à dire. Comme le Biafra en 1968, ou le Kosovo, ou le Darfour, la Palestine concerne le monde entier, la conscience israélienne, la conscience juive, la conscience humaine. Grâce à la mondialisation de l’information et aux multiples relais des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales, un « espace public international » s’est constitué.
A cet égard, le travail critique des intellectuels joue un rôle fondamental dans la déconstruction des lignes rouges et des murs d’incompréhension. Le besoin de produire des arguments et des instruments d’interprétation (par exemple aux Nations Unies, devant la Cour internationale de justice, dans la presse qui forge largement les opinions), est une nécessité quasi stratégique. L’effort loyal de compréhension de la part des intellectuels par rapport à la question israélienne nourrit ce débat au sein de l’espace public international et, espérons-nous, permet de construire le langage commun du droit et de la justice qui est tout sauf un dernier mot.
William Ossipow
Ce texte est un extrait de la préface de l’ouvrage universitaire « Israël et l’autre » publié chez Labor et Fides en 2005 dont nous vous conseillons la lecture.








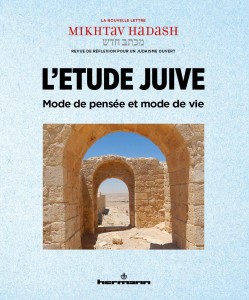


Messages
Il s’agit en effet d’un ouvrage très intéressant qui ouvre le débat. Il vaut la peine de prendre le temps de le lire et de le méditer. Je saisis l’occasion pour vous féliciter pour votre site internet ainsi que pour vos prises de position courageuses.
Sarah C.