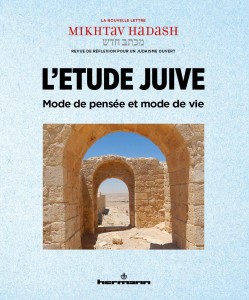Aucune religion n’a poussé si loin l’idée de législation divine, de vision juridique de la spiritualité. Pour le judaïsme la Loi, la Halakha , représente-t-elle le concept d’interdit symbolique, un modèle de discipline personnelle ou forge-t-elle un véritable projet de société apte à répondre à tous les problèmes ?
Voici le début de la Parasha Shoftim :
« Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l’Éternel, ton Dieu, te donnera, dans chacune de tes tribus ; et ils devront juger le peuple selon la justice. Ne fais pas fléchir le droit, n’aie pas égard à la personne, et n’accepte point de présent corrupteur, car la corruption aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes. C’est la justice, la justice seule que tu dois rechercher, si tu veux te maintenir en possession du pays que l’Éternel, ton Dieu, te destine. » (Deutéronome 16.18-20)
D’après la Tora et nos sages , il y a donc une Mitsva d’instituer des tribunaux, c’est le 491e commandement expliqué ainsi par un de nos ouvrages majeurs :
« Juges qui ont pour mission d’obliger les gens à observer les lois de la Tora… afin que les commandements et les interdictions de la Tora ne soient pas laissés à l’appréciation arbitraire de tout un chacun. » (Sefer Hah’inoukh 13e-14e siècle)
Bien entendu l’intention est louable : comme le verset l’indique, il s’agit de poursuivre la justice. Il s’agit d’enseigner aux gens à faire le bien et à respecter l’ordre social et moral, tel que la Tora le pense. Or la Tora touche à tous les domaines de la vie, c’est un système juridique global qui est censé répondre à tout de la meilleure manière possible.
En diaspora :
En situation de diaspora, les tribunaux en question sont les tribunaux rabbiniques communautaires, dont le domaine de compétence reste réduit. De fait, le droit juif, la Halakha talmudique, fut élaborée en situation de diaspora à une époque où l’autonomie juridique des Juifs était sur le déclin. Durant la période médiévale, l’autonomie juridique se limitait aux affaires communautaires, au droit des personnes et à certains conflits entre individus au sein de la communauté. Au fur et à mesure de l’intégration des Juifs dans la société et du renforcement du pouvoir central des Etats, cette autonomie alla en se réduisant encore plus. L’émancipation des Juifs leur apporta le statut de citoyens de plein droit et mit donc un terme à la dimension juridique des communautés juives. Si des tribunaux rabbiniques existent encore aujourd’hui, leurs fonctions sont extrêmement restreintes.
Depuis l’émancipation, chaque individu est libre d’aller ou non devant les tribunaux rabbiniques et de leur obéir. En général, ces tribunaux ne traitent que de questions rituelles (conversion au judaïsme, divorce religieux préalablement soumis au divorce civil, kashrout …) et tiennent parfois le rôle d’arbitraire lorsque les deux partis le souhaitent.
Ces tribunaux rabbiniques existent donc encore, il y en a même dans chaque courant du judaïsme. Ils fonctionnent sans trop de problèmes, produisant une jurisprudence féconde dans un champ du droit très restreint. De toute façon, ces tribunaux n’ont aucune autre autorité que celle accordée par la bonne volonté des individus. Ils n’ont aucun moyen pour forcer l’application de la loi.
En Israël :
Mais qu’en est-il lorsque le peuple juif acquiert son indépendance ?
Le Sefer Hah’inoukh est clair : « La présente mitsva est une de celles qui concernent la Communauté dans son ensemble et en tout lieu. Grave serait la responsabilité de la communauté qui n’aurait pas créé les institutions judiciaires exigées par la loi, alors qu’elle en avait le pouvoir. (…) Il est indispensable, bien entendu, que ces hommes jouissent de la confiance de leurs coreligionnaires, qu’ils aient une conduite irréprochable. Il ne faudrait pas que lorsqu’ils demandent à un tel d’enlever la paille qu’il a entre ses dents, celui-ci leur réponde ; enlève d’abord la poutre qui te couvre les yeux. »
L’Etat d’Israël a été créé par un mouvement d’émancipation laïc et son système juridique se construit sur un modèle occidental avec, en son centre, l’idée de la protection des individus et de leurs libertés individuelles. Seul le domaine du droit des personnes (mariage et divorce) est laissé à la compétence des tribunaux confessionnels, d’après un modèle hérité de l’Empire ottoman dans lequel chaque communauté religieuse avait une part d’autonomie juridique.
Mais la création d’un Etat laïc posa un défi à la pensée juive religieuse et explique pour une grande part l’opposition de la majorité du camp orthodoxe au sionisme.
En Israël aujourd’hui, on assiste à une sorte de Kulturkampf :
D’un côté, la société démocratique séculière fonctionne grâce à des institutions juridiques qui sont devenues peu à peu les garants de la démocratie israélienne et des droits de l’homme en créant depuis une soixantaine d’années un droit israélien répondant aux critères des démocraties occidentales. Au sommet de ce système se trouve la Cour suprême qui, en l’absence de Constitution, est le garant des droits individuels et du respect des normes internationales.
De l’autre côté, une partie radicale du judaïsme orthodoxe voudrait, en toute logique, voir appliquer les règles juridiques de la Tora au sein de l’Etat juif et voue aux gémonies le système judiciaire israélien et en particulier la Cour suprême.
Cette situation de conflit larvé devient particulièrement épineuse lorsque la Cour suprême oblige les institutions religieuses à respecter les critères de la démocratie occidentale. Ce problème est récurrent et régulièrement la tension monte entre les deux parties.
Ce fut par exemple le cas récemment, en 2010-2011, lorsqu’une école religieuse à majorité ashkénaze fut déclarée par la Cour suprême non conforme aux normes démocratiques que le ministère de l’éducation nationale se doit d’appliquer. Cette école pratiquait une politique de discrimination envers les élèves d’origine sépharade : une stricte séparation était opérée entre les enfants selon leur origine, y compris dans la cour de récréation ! Les élèves d’origine sépharade étaient considérés comme ayant une mauvaise influence religieuse sur ceux d’origine ashkénaze, aux normes plus strictes. Du coup, les subventions de l’Etat accordées à cette école furent suspendues. Les autorités religieuses proches de cet établissement qualifièrent la décision de la Cour suprême de « satanique ». Une manifestation monstre de dizaines de milliers de religieux fut même organisée à Jérusalem contre la Cour suprême avec la bénédiction de nombreux rabbins connus.
Cet exemple récent reste anecdotique et ne relève pas vraiment de la Halakha mais montre, une fois de plus, l’extrême sensibilité du monde orthodoxe dès que l’Etat se mêle de son pré carré (tout en souhaitant recevoir des financements publics).
On pourrait facilement dresser une longue liste de conflits majeurs entre la Halakha et le droit contemporain, notamment en ce qui concerne les droits individuels, qu’il s’agisse de ceux des femmes, des homosexuels, des non-pratiquants, des non-juifs, des libres penseurs... et même des enfants (on a vu ainsi des députés h’aredim s’opposer au vote d’une loi interdisant les punitions corporelles contre les enfants au prétexte que la Bible le demanderait selon Proverbes 13.24 : « celui qui économise son bâton déteste son fils »)…
Cela ne veut pas dire que la Halakha est un système totalement dépassé, loin de là, mais la Halakha correspond dans bien des cas à des critères d’une autre époque et d’une autre société que ceux du peuple juif actuel. La Halakha repose sur les principes d’une société religieuse mettant Dieu en son centre, soumettant l’individu jusque dans sa vie privée aux critères moraux et sociaux du groupe, basée sur la famille et le patriarcat et ne connaissant pas l’idée contemporaine de liberté de conscience ou de séparation entre religion et Etat.
On peut répondre que la Halakha propose le bon modèle, contrairement à celui de l’Occident décadent, mais ce discours tiendrait-il vraiment l’épreuve de la réalité ?
On peut réduire la Halakha à des domaines purement religieux et symboliques, comme c’est le cas dans tout le judaïsme actuel, mais c’est en limiter singulièrement la portée initiale.
Un conflit insoluble et révélateur :
La situation de l’Etat d’Israël actuel place le judaïsme face à ses responsabilités historiques, culturelles et religieuses. Les rapports entre Halakha et réalité étatique représentent un excellent moyen de réflexion sur la portée réelle de la loi juive et sa nature. Quel rapport peut avoir un Etat moderne avec la loi religieuse ancestrale ? La Halakha , qui est censée représenter le modèle ultime de la Loi et de la Morale, peut-elle répondre aux normes juridiques et éthiques qui sont les nôtres aujourd’hui ? Nos normes doivent-elles s’effacer devant celles de la Halakha ?
Voici les diverses options possibles :
1. La situation actuelle. Le droit israélien est un droit occidental obéissant aux critères de la démocratie libérale. Le droit religieux est relégué au domaine de la vie privée. La situation de la halakha en Israël se trouve donc aux au même niveau qu’en diaspora.
2. La mise en place d’un Etat se pliant à La Tora. La Cour suprême actuelle serait remplacée par une cour rabbinique. Le droit appliqué serait celui de la Halakha . Cela correspond au souhait d’une partie de l’orthodoxie .
3. Le système actuel serait maintenu en cherchant à appliquer au maximum le droit de la Tora, mais celui-ci subirait alors une adaptation le rendant compatible avec les critères occidentaux.
Si on y regarde bien, toutes ces solutions sont mauvaises.
La première solution comporte l’avantage immense d’être conforme à l’éthique contemporaine et de protéger l’individu, mais de l’autre côté, elle représente un véritable désaveu de la Tora. Il y a en effet une belle ironie à ce que le peuple juif enfin autonome, évite soigneusement de mettre en place une juridiction conforme à sa loi ancestrale ! Bien entendu, cette solution est conforme aux souhaits de la partie laïque et démocratique du pays et de celui des fondateurs qui étaient tous des laïcs occidentalisés.
Mais dans le fond, elle arrange bien le monde orthodoxe et lui évite de prendre ses responsabilités. En effet, les rabbins orthodoxes seraient bien embêtés s’ils devaient un jour gouverner l’Etat d’Israël et dans l’ensemble, ils préfèrent garder leurs distances. Les députés religieux ne s’occupent vraiment que de défendre leurs intérêts sectoriels ou la question des mariages, mais ne proposent pas de véritable programme politique. Mais n’y a-t-il pas ici un aveu implicite de l’aspect obsolète d’une grande partie de la loi juive et donc de toute la conception orthodoxe elle-même ?
La deuxième solution, offrant le pouvoir juridique aux rabbins , mettrait en place une sorte d’Etat théocratique fonctionnant sur les critères de la Halakha classique, ce qui serait un désaveu profond du principe des droits de l’homme et des critères démocratiques occidentaux. L’Etat d’Israël fonctionnerait certainement, mais on obtiendrait un résultat assez proche de la république iranienne des mollahs.
Non seulement cela ne correspond pas au désir de la majorité des Juifs, et même si les orthodoxes devenaient la majorité, prenaient le pouvoir démocratiquement (ce qui est actuellement une fiction réaliste) et mettaient en place un tel système, je doute fort que le résultat susciterait l’admiration du monde contrairement au but recherché par le Deutéronome 4.6 : « Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, car lorsqu’ils auront connaissance de toutes ces lois, ils diront : Elle ne peut être que sage et intelligente, cette grande nation ! ». Le judaïsme serait en effet souvent ridiculisé et les rabbins se retrouveraient empêtrés dans une loi inapplicable sans réforme de fond, chercheraient à mettre en pratique tant bien que mal des conceptions politiques et morales obsolètes, voire utopiques et irréalistes.
La troisième solution correspondrait grosso modo à la vision massorti et modern-orthodoxe , liant étroitement Halakha classique, pluralisme et démocratie. Elle ne fonctionnerait pas très bien non plus car la distance qui sépare les critères du droit contemporain de ceux de la tradition juive, rendrait la tâche extrêmement difficile, voire impossible.
Pour rendre conforme l’ensemble de la Halakha aux normes juridiques contemporaines, il faudrait une telle réforme de fond, tant d’interprétations audacieuses et de takanot (décrets rabbiniques) que cela dénaturerait les fondements mêmes de la Halakha . Il deviendrait impossible de garder comme référence absolue les textes bibliques et talmudiques tels que la tradition les lit classiquement ; il faudrait passer outre une énorme quantité de textes halakhiques de base, comme le Mishné Tora, le Shoulkhan Aroukh et une quantité de Teshouvot .
Techniquement la Halakha peut répondre à tous les problèmes, elle représente un droit extrêmement élaboré et dynamique. Le problème n’est donc pas technique, il est conceptuel. La Halakha n’étant tout simplement pas basée sur les mêmes normes que celles qui fondent le droit occidental. Des juristes israéliens se sont intéressés à ce problème et ont écrit divers ouvrages sur ce que l’on appelle « hamishpat haïvri » ; mais leurs travaux ne sauraient convaincre un véritable orthodoxe , car le résultat est trop éloigné du système classique. Les orthodoxes s’opposeraient donc toujours à ce droit, tout comme ils s’opposent déjà à la jurisprudence Massorti , pourtant très traditionnelle, dans le domaine du rituel, ainsi qu’ à la Cour suprême dans le domaine du droit israélien.
Le paradoxe du judaïsme contemporain :
Nous touchons ici au paradoxe des mouvements juifs halakhiques modernistes (massorti et modern-orthodoxes ). Ces mouvements se disent attachés à la loi ancestrale tout en voulant le pluralisme, la démocratie et les droits de l’homme…
De ce point de vue, les réformés, qui renoncent à la halakha et les orthodoxes , qui eux n’acceptent pas les normes occidentales contraires à la Halakha s’inscrivent, chacun à sa manière, dans un système apparemment plus cohérent. Le problème est que les réformés, en renonçant à la Halakha , délaissent un aspect essentiel du judaïsme ; tandis que les orthodoxes , en renonçant aux normes occidentales, figent le judaïsme dans son aspect médiéval et le rendent obsolète pour la plupart des Juifs (je dirais même y-compris pour la majorité des Juifs qui se disent orthodoxes mais ne sont pas du tout prêts à vivre dans une théocratie et à renoncer à tous les bienfaits du modèle occidental dont ils profitent pleinement).
En tant que partisan de la solution intermédiaire cherchant à conserver la Halakha tout en acceptant bien volontiers, comme un progrès réel, les normes occidentales, je ne vois donc pas d’autre solution que d’accepter de profaner la lettre de ce 491e commandement et de renoncer, au nom même de l’idéal religieux de justice, à son application telle que le Sefer Hah’inoukh la définit. Je pense sincèrement que ce serait une catastrophe si l’Etat d’Israël devenait une théocratie et je souhaite de tout cœur que la Cour suprême continue à l’emporter dans le bras de fer avec les orthodoxes .
Là-dessus, ce que dit le Sefer Hah’inoukh est dépassé par la réalité : « La présente mitsva est une de celles qui concernent la Communauté dans son ensemble et en tout lieu. Grave serait la responsabilité de la communauté qui n’aurait pas créé les institutions judiciaires exigées par la loi, alors qu’elle en avait le pouvoir. » Nous sommes face à un paradoxe : voilà une mitsva aujourd’hui techniquement applicable mais non souhaitable pour le bien du judaïsme lui-même !
Je pense qu’il en est de même pour l’injonction « d’obliger les gens à observer les lois de la Tora… afin que les commandements et les interdictions de la Tora ne soient pas laissés à l’appréciation arbitraire de tout un chacun. » Que serait un Etat dans lequel on obligerait les gens à respecter les lois rituelles du judaïsme ? Que serait une société dans laquelle l’arbitraire de la pensée religieuse et rituelle individuelle serait contrôlé ?
Un des grands apports de la modernité, de la Haskala au sein du judaïsme, c’est le respect de la liberté individuelle, de la liberté de conscience en particulier. Or la Halakha , s’étant forgée dans un monde pré-médiéval et médiéval, n’en tient pas compte et propose de punir les transgressions rituelles au même titre que les transgressions morales ou les agressions envers autrui. Que serait une société juive qui renierait tous les apports de la Haskala et verrait ceux-ci comme illégaux ?
Le grand paradoxe, c’est que nous sommes attachés aux valeurs occidentales parce que nous sommes attachés à une certaine idée de la justice. Or la Tora nous indique qu’il faut poursuivre la justice ! Mais la justice, le « tsedek », est-elle une conception philosophique que le droit doit chercher à promouvoir sur le terrain (ce qui est la conception occidentale et celles des juifs modernes) ou est-ce une notion définie par les règles du droit révélé, qui en fixent les limites (conception juive orthodoxe ) ?
Par exemple, le fait de considérer une femme comme inégale en droit à l’homme, ainsi que le fait la Halakha , est-il injuste (occident et juifs modernes) ou du fait que la loi le dit, c’est forcément juste (judaïsme orthodoxe ) ? Qui énonce ce qui est juste ou non ? Que veut dire le verset de la Tora « C’est la justice, la justice seule que tu dois rechercher » ? Finalement, nos conceptions modernes du bien et de l’importance de l’individu ne puisent-elles pas aussi leur inspiration dans le texte biblique lui-même ?
Un des grands apports de la Haskala , c’est d’accorder toute sa place et son autorité à l’idée de conscience individuelle. La norme du bien, la norme du juste, n’est plus seulement ce que me dit le texte ancestral, mais également ce que dicte la conscience individuelle, ce que produit la réflexion éthique, ce à quoi aspire la société, ce qu’exige la dignité actuelle de l’individu. De nos jours, du point de vue moderne, « poursuivre la justice » exige de nommer des juges tels ceux de la Cour suprême israélienne pour qui le droit occidental l’emporte sur les textes juridiques de la tradition ! Abandonner le pouvoir juridique aux rabbins qui veulent appliquer strictement la tradition, ce serait bafouer la justice ! C’est là tout le défi du judaïsme contemporain.
Cela est vrai au niveau des questions judiciaires (droit pénal, droit commercial, droit civil et droit public) pour lesquelles il me semble difficile, voire impossible, d’appliquer le droit hébraïque sans contredire sévèrement les principes du droit occidental et de la justice selon les normes actuelles.
Mais cela est vrai également au niveau des questions rituelles et religieuses (au sens étroit du terme), qui ne sauraient être imposées aux individus. Pour la Haskala , ces questions relèvent de la conscience individuelle et de l’engagement libre de chacun ; contrairement au langage du Sefer Hah’inoukh, les règles de la Tora sont forcément livrées à « l’arbitraire des individus » qui choisissent ou non de les appliquer dans leur vie privée.
Dans le monde juif contemporain, la Halakha existe encore, mais tout d’abord elle représente une norme qui n’est plus absolue et qui ne correspond plus, dans bien des domaines, aux besoins, à la mentalité et à l’éthique des Juifs contemporains. Même dans le camp orthodoxe , seule une minorité serait prête à payer le prix de l’application de la Halakha à tous les niveaux, que ce soit pour gérer l’Etat, ou simplement leur vie courante au-delà des seules questions de rituel.
Ce n’est pas une catastrophe pour la Halakha , mais cela montre bien ce qu’elle est devenue : une discipline personnelle que nul ne peut me forcer à adopter, que je peux toujours contester et dont les domaines d’application se limitent, dès lors qu’ils viennent heurter ma conscience, ma sensibilité et au niveau d’une nation, les grands principes des démocraties occidentales. En précisant bien que ces limites posées par la modernité à la Halakha n’enlèvent pas sa pertinence et sa nécessité comme expression majeure de la spiritualité et de l’éthique juive.
Contradictions éthiques et normatives du judaïsme :
Cela montre également qu’il y a une forme de contradiction interne, au sein même du judaïsme, entre l’aspiration à une éthique supérieure, par exemple l’injonction à poursuivre la justice, et les normes juridiques de nos textes classiques qui sont forcément le reflet de la mentalité de l’époque et ne représentent donc pas une valeur absolue et hors du temps. Il y aurait donc paradoxe à vouloir appliquer toute la Tora, puisque la norme juridique se heurte régulièrement au souffle éthique des mêmes textes.
Cette contradiction n’est pas forcément un défaut et elle est peut-être voulue a priori afin de ne pas figer le discours en l’enfermant dans les normes d’une époque.
Ce problème traverse toute la littérature rabbinique, mais se trouve déjà dans la littérature des prophètes et même dans le texte du Pentateuque.
Cela nous amène à poser une autre question : la littérature
talmudique, qui se présente sous la forme d’une littérature juridique, en est-elle vraiment une au sens strict ? Les rabbins avaient-il véritablement la volonté d’appliquer le droit dont ils discutaient ? Sur plusieurs des points soulevés dans la littérature talmudique, il semble bien que oui. Mais alors pourquoi discuter de sujets déjà inapplicables à l’époque de la discussion et même souvent purement théoriques, ce qui est le cas d’au moins la moitié de la littérature talmudique ? La forme même de la discussion talmudique ne cherche pas vraiment à aboutir à une règle définie ; en général la discussion ne se conclut pas vraiment et parfois les voies les plus farfelues sont sérieusement explorées. Un juriste cherche au contraire la clarté et la synthèse, il ne s’occupe que de cas pratiques et veut que la loi soit applicable et efficace. Il semble bien que la discussion talmudique se sert de questions juridiques pour parler le plus souvent d’autre chose. On serait alors face à une casuistique ou une rhétorique juridique ne cherchant pas forcément à créer du droit, mais plutôt une sorte de philosophie juridique, un droit surréaliste en quelque sorte. Chacun ou chaque époque, puisant à cette discussion pour reformuler si besoin, la meilleure façon d’agir, chaque juge ayant alors grande liberté dans son interprétation et toujours la possibilité de reprendre la discussion à la base.
Toutefois, on peut également poser cette question au niveau du texte de la Tora lui-même : voulait-il établir une norme juridique définitive ou bien cherchait-il à entamer une discussion et à offrir un modèle plutôt flou dans de nombreux domaines du droit et servant de base à une juridiction en constante évolution ? On peut sérieusement envisager que la Tora ne fut jamais une véritable législation pratique, même si souvent des cas concrets sont proposés, mais plutôt une source d’inspiration et un modèle pour des discussions ouvertes (le concept de Loi oral en découle logiquement d’ailleurs). Bien évidemment cela ne fonctionne pas pour certains points très développés comme celui du rite sacrificiel, mais ces prescriptions détaillées renforcent l’impression de flou du reste, notamment de domaine très pratiques du droit qu’il fallait forcément trancher d’une façon ou d’une autre.
C’est là toute la différence entre des textes strictement juridiques (souvent fort bien écrits) et des textes littéraires : le but poursuivi n’est pas du tout le même. La Tora au sens large (Bible et Talmud ) me semble osciller entre les deux genres, les mélangeant au point que le littéraire omniprésent rend le juridique bien irréaliste et relevant au final d’une littérature inclassable.
Bien évidemment, pareille thèse, allant à l’encontre de l’enseignement classique, mériterait un long développement. Mais on peut néanmoins émettre l’hypothèse que le fait que des rabbins médiévaux, Maïmonide en tête, aient voulu traduire en norme juridique définie une littérature talmudique qui ne le demande pas forcément, relève de leur conception particulière, reflet de leur époque où le monde se veut cohérent et ordonné. Qui nous dit que la conception juridique des rabbins médiévaux n’aurait pas surpris les auteurs de la Bible ou ceux de la partie ancienne du Talmud (les stamaïm qui concluent le texte talmudique ayant déjà entamé le développement normatif uniformisant qui prendra tout son poids au Moyen-âge) ?
Bien évidemment, nous sommes ici face à une discussion technique d’une grande complexité faisant appel à toutes les données de la recherche juive universitaire contemporaine, qui démontre clairement l’existence d’un processus d’évolution au sein du discours talmudique.
Si on accepte cette hypothèse et que celle-ci soit étayée correctement, cela pourrait résoudre une bonne part des difficultés du droit hébraïque actuel. Passant outre la vision médiévale, on envisagerait alors la discussion talmudique, non comme une discussion normative nous imposant ses conclusions, mais comme un modèle de réflexion n’empêchant nullement la continuité de la discussion ou l’introduction de donnée éthiques ou casuistiques nouvelles. Ce serait contraire à la conception halakhique médiévale et donc classique pour nous, mais ce serait un véritable renouvellement de la pensée juridique juive.
On pourrait très bien imaginer alors un système judiciaire israélien puisant largement son inspiration non plus seulement dans le droit anglo-saxon, mais dans les textes classiques du judaïsme, codes médiévaux et Teshouvot rabbiniques compris ; les rediscutant toujours, sans pour autant déroger ni à l’esprit du droit contemporain, ni à celui des prophètes d’Israël appelant à la justice et à l’éthique universelle. Une vision dynamique de la Halakha ne voulant nullement dire un déni de son autorité, bien au contraire.
Mais là encore, même si cela était éventuellement compatible avec le fond du débat talmudique vu sous cet angle, et si les juristes israéliens étaient prêts à pareille gymnastique, cette conception ne pourrait néanmoins qu’horrifier un orthodoxe , qui n’y verrait donc rien de légitime… Nous voilà donc « teko », me semble-t-il…
Conclusion :
Notre discussion montre bien que le judaïsme contemporain se trouve déchiré entre deux conceptions très différentes du judaïsme normatif.
Les uns veulent voir dans les textes classiques du judaïsme une norme absolue relevant d’une vérité éternelle qu’il faudrait dans l’idéal appliquer dès que possible… pour eux, les normes de la modernité sont bien évidemment à détruire. Pour les autres, les textes classiques reflètent une dynamique spirituelle profonde, un mouvement éthique continu, qui ne doit pas cesser et pourrait éventuellement intégrer les grands principes du droit contemporain.
Il n’y a pas de différence d’authenticité entre les deux conceptions, toutes deux puisent leur essence dans la tradition et cherchent à « magnifier le Nom du ciel ». La conception classique relève d’un monde immobile. La conception moderne relève d’un monde en mouvement. Dieu lui-même peut être conçu selon une ou l’autre conception, ce qui ouvre des perspectives immenses qu’on ne va pas développer ici.
Mais il me semble clair qu’il est manichéen et superficiel de penser que le judaïsme doit absolument répondre aux normes des penseurs médiévaux et que du coup, le discours orthodoxe doit être le seul possible, ou que le discours du judaïsme moderniste manquerait d’authenticité et de pertinence.
Le judaïsme est de toute évidence à un tournant majeur de son histoire. Depuis qu’il existe un Etat disponible, il se trouve face à ses contradictions et se doit d’y répondre, d’une façon ou d’une autre. Quel projet le judaïsme halakhique propose-t-il à cet Etat ? A nous d’y réfléchir et d’imaginer des solutions authentiques et viables ou d’accepter qu’il n’y en a peut-être pas et qu’au bout du compte, faute de mieux, la situation actuelle, contredisant nos textes classiques, reste finalement la moins mauvaise... L’essentiel restant, quoi qu’il arrive, de poursuivre la justice… et comme le dit le Rav Simh’a Bunem à propos de la répétition du mot « tsedek » dans le verset : de poursuivre la justice avec l’idée même de justice. Ce à quoi s’emploie justement la Cour Suprême israélienne, n’en déplaise à ses détracteurs.
Yeshaya Dalsace
(Parashat Shoftim 5771)