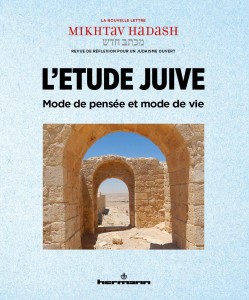Je me permettrai seulement de suggérer quelques pistes de réflexion sur le défi que constitue la prise en compte des disciplines de l’histoire et de la pensée dans l’enseignement et l’étude du judaïsme. Pour ce faire, je me propose simplement de nous mettre sous les yeux un certain nombre de clichés, slogans ou idées reçues qui à mon sens parasitent la vitalité d’esprit, en amont de toute analyse particulière.
À bien des égards, l’enjeu d’aujourd’hui révèle d’une question fondamentale : le judaïsme est-il une conception/religion (mode de vie, etc.) autosuffisante ? Autrement dit, les enseignants du judaïsme doivent-ils pour lui être fidèle, tâcher de n’en donner le sens et l’interprétation qu’à la lumière des seules sources intérieures dites « autorisées », Bible, Talmud , littérature rabbinique, midrachique, halakhique et cabalistique ? Ou au contraire, peuvent-ils, doivent-ils, également puiser dans d’autres disciplines du savoir telles les sciences, l’histoire, la philosophie, la psychologie et plus globalement les sciences naturelles et humaines, telles l’anthropologie, la sociologie, la linguistique, etc. ?
La question mérite bien d’être posée car l’on entend souvent des relents de débat notamment au sein de la communauté consistoriale autour de la nécessité de conférer un enseignement universitaire au séminaire rabbinique, aux côtés de l’enseignement classique de Yechiva. Le point de vue radical exprimant un refus catégorique peut parfois s’exprimer au travers d’une lecture très orientée, « intégraliste », d’une maxime des Pères (5:26) : « Ben Bag Bag disait : Tourne et retourne la Tora en tout sens, car tout est en elle. » Entendu comme : Si toute la sagesse est contenue dans la Tora, nous n’avons rien à apprendre d’essentiel ailleurs. C’est au contraire, pure perte de temps et d’énergie, et risquer des complications inutiles… Mais est-ce vraiment ce que voulait dire Ben Bag-Bag ? Permettez-moi d’en douter. À mon sens, cette maxime révèle toute sa pertinence si on se contente d’en entendre que la sagesse de la Tora est inépuisable et que l’effort de l’investir doit être constant. Il ne convient pas de forcer le trait, en en tirant des conclusions chauvines et exclusivistes.
Derrière cette question de principe, se profile une grave question qui fait peser pour certains –c’est ainsi qu’ils le formulent – la menace de voir le judaïsme subir la contamination de conceptions et de pratiques qui lui sont étrangères, au risque de le corrompre, de l’altérer, de le trahir. Avec le recours à un outil externe, à un second paramètre de référence, se profile l’accusation d’agent double. La duplicité dénoncée entraîne alors logiquement l’anathème et la damnation des hérétiques, comme jadis celle de « ceux qui lisaient les sefarim hitsonim (livres apocryphes, hors canon biblique rabbinique) » , bien qu’il s’agisse encore une fois, faut-il le préciser, d’une lecture très autoritaire et étroite de cette ancienne condamnation. Le discours dit « occidental », philosophique et scientifique apparaît alors comme le fruit séduisant et perfide porté par tel Méphistophélès ou serpent primordial…
On ne doit pas sous-estimer cette impression de menace, ni le sentiment de culpabilité qui l’accompagne. Il pèse sur bon nombre de consciences et inhibe toute pensée novatrice. Je citerai un bref exemple où cela prend corps et forme de slogan : la fameuse formule de « Naâssé ve-nichmâ » que les enfants d’Israël ont prononcée, selon le récit de l’Exode, au pied du mont Sinaï, est souvent interprétée – je dis bien « interprétée » – comme signifiant : « Nous ferons ce qui nous est ordonné de faire, et ensuite seulement, nous adhérerons en pensée et en conviction à ce qui nous aura été ordonné. » Poussée jusqu’au bout, cette posture intellectuelle consisterait à ne mettre en oeuvre notre réflexion qu’au service de la justification et de l’approbation de ce qui a été édicté, c’est-à-dire en suppression totale de tout sens critique et de tout effort d’adéquation aux nouvelles réalités. C’est promouvoir un circuit fermé où la pensée inféodée sert seulement d’autojustification, comme si le monde environnant ne servait que de décor et non de stimulation, d’interaction. Un jour, alors que j’étais en débat public avec un rabbin de tendance radicale, je lui citais en exemple d’évolution sociale positive : l’abolition de l’esclavage. Il me répondit que l’on ne pouvait considérer cela comme une avancée car une bonne partie des commandements de la Tora est consacrée aux lois de l’esclavage. Il convenait donc, selon lui, aux temps messianiques, que la société redevienne celle où prévalaient ces lois, pour que la Tora puisse à nouveau déployer toute son envergure, selon encore une sorte de slogan : ce n’est pas à la Tora à aller vers la société mais la société à aller vers la Tora… N’allez pas croire qu’il s’agit là de pure caricature. Pour un trop grand nombre, intellectuellement parlant, les adaptations de la Loi ne sont jamais que des concessions imposées de l’extérieur que le messie saura révoquer.
Bien sûr, les plus réfractaires en la matière savent prétendre qu’ils ne sont pas hermétiquement fermés au monde moderne, et pour ce faire, en appellent à cette autre maxime des Pères (2:14) : « Rabbi Elâzar dit : Sache quoi répondre à l’hérétique ». Pour répondre à l’hérétique, il faut forcément aller gambader sur son terrain et acquérir un certain savoir qui passe par d’autres constellations intellectuelles et émotionnelles. Mais la question posée ici est bien plus fondamentale, elle n’est pas seulement tactique mais stratégique. Elle est vitale. Pour prendre la métaphore de l’homéostasie – le fait que tout organisme vivant tende à s’autoréguler en interagissant avec le milieu environnant pour se maintenir en vie – il ne s’agit pas seulement pour survivre de se fabriquer des anti-corps mais de se demander s’il existe à l’extérieur des éléments nutritifs. Ou, si vous voulez : « Est-il bon pour les juifs » de prendre en compte les évolutions sociales du monde et de connaître les sagesses du monde ? Une des formulations classiques des plus tranchées en la matière n’est autre que celle attribuée au fameux Gaon de Vilna (1720-1797) qui déclarait que « Toute lacune dans la connaissance des sciences entraîne une carence démultipliée au centième du savoir juif. En effet, Tora et sciences sont indissociables et ce serait du reste, un hiloul ha-chèm (profanation du nom de Dieu) que de provoquer l’hilarité des non-juifs se gaussant de la médiocrité et de l’ignorance de la nation juive » (cf. propos rapporté par le disciple R. Baroukh de Sklov, Introd. au livre d’Euclide traduit en hébreu). Ce qui rejoint la vision idéalisée présentée par la Tora elle-même : « Les peuples reconnaîtront qu’il s’agit d’un grand peuple, doué de sagesse et de discernement » (Dt 4:6-8). Les « autres » ne peuvent évidemment reconnaître la sagesse d’Israël que parce qu’ils s’y repèrent eux-mêmes, selon leurs propres critères, autrement dit car il existerait des accointances, des résonances, des passerelles avec leurs propres préoccupations et conceptualisations.
Dans le milieu traditionnel, le positionnement à l’égard de la science relève trop souvent d’une pseudo-prise en compte des méthodes et données de la science, traduisant une posture « apologétique » dont le but réel n’est pas la recherche de la vérité mais de « sauver le système de croyances » en état, à une époque donnée. Ainsi, l’attitude adoptée est souvent « concordiste », c’est-à-dire qu’elle ne s’intéresse à la science et n’en recueille des éléments d’information qu’à la condition que ses découvertes ou ses assertions corroborent ou concordent avec certaines doctrines prises comme des dogmes. Ainsi peut-on trouver dans des commentaires populaires que les fossiles anthropoïdes, hominoïdes puis homonidés retrouvés sur les sites archéologiques sont en réalité des hommes ayant dégénéré en singes (pour leur immoralité) et non des ancêtres proches du singe, témoignant d’un stade précoce de l’évolution humaine. Pourquoi ? Car il ne se peut pas qu’il ait pu exister une humanité « avant » le Adam biblique. On n’est d’ailleurs pas plus scientifique dès lors que l’on affiche une conception élastique de la notion de « jour » en proclame que les six jours de la Création ne sont pas vraiment des jours mais des ères, et que considérés ainsi, 15 milliards d’années peuvent bien se compresser en six jours symboliques. On aurait procédé à cette astucieuse pirouette que le problème resterait entier. En effet, le Adam biblique a tout au plus 6000 ans, selon tous les calculs partant de la Bible alors que l’apparition des anthropoïdes à son stade primaire se situe, selon les évaluations actuelles, à quelques sept millions d’années. À moins de considérer aussi que les jours et les années depuis Adam n’en sont pas non plus… Il est sans doute fâcheux que soit ainsi établie une contradiction flagrante entre le discours biblique et scientifique mais la maturité intellectuelle consiste à assumer les contradictions plutôt qu’à les faire disparaître sous le tapis. Autrement dit, il conviendrait sur le plan religieux de redéfinir les modalités de la véracité et de la pertinence de l’un et l’autre discours, c’est-à-dire d’admettre que la vérité biblique s’évalue selon un autre registre de préoccupation que celui de la facticité historique. Et en même temps, il ne faut pas non plus, comme trop souvent aussi, prendre le discours scientifique comme Tora min ha-chamaïm ou si vous préférez, « parole d’évangile »… en tombant dans l’excès inverse de la dogmatisation du discours scientifique. La science a beau être sérieuse en ce qu’elle use méthodiquement de raison, elle n’échappe pas à l’aléatoire, à l’approximatif, à l’hypothétique.
L’essentiel est donc l’honnêteté de la démarche intellectuelle. Est-il même concevable qu’il en aille autrement en matière de religion ? La Tora ne dit-elle pas : « Tu t’éloigneras de tout propos mensonger » (Exode 23:7) ? Ainsi peut-on lire ce texte intégré dans la liturgie quotidienne : « L’homme doit constamment porter en lui la crainte de Dieu, en secret comme en public, reconnaître la vérité et la restituer avec honnêteté » (Tanna de-bé Eliyahou 21). De la probité intellectuelle dépend la crédibilité même du discours religieux ! Évoquons rapidement deux citations de Maïmonide qui ont une valeur emblématique. Il écrit dans son introduction au Traité des huit chapitres qui traite d’éthique : « Accepte la vérité de quiconque l’a énoncée. » Ou encore, dans le Guide des égarés (2:23) : « La comparaison (entre deux opinions) ne pourra être établie avec profit que par celui qui attacherait une égale valeur aux deux hypothèses contraires ; mais si quelqu’un, soit à cause de son éducation, soit par un intérêt quelconque, préférait (d’avance) l’une des deux opinions, il resterait aveugle pour la vérité » !
Qui a alors peur du grand méchant loup ? Faut-il protéger le discours de la Tora de toute enquête honnête et objective car cela ne manquerait pas inéluctablement de faire effondrer toutes nos convictions et engagements ? Notre foi serait-elle à ce point inconsistante et vulnérable pour devoir la prémunir de toute contestation ? N’est-ce pas la vérité elle-même qui nous échappe en l’absence de véritable confrontation ? La Tora ne dit-elle pas (certes, dans le domaine juridique mais la transposition est tout à fait valable sur le plan épistémique) : « Un témoignage isolé ne sera pas valable […) C’est par la confrontation de deux ou trois témoignages qu’un fait sera avéré » (Dt 19:15) ?
Il faut dire à tous les éducateurs que la confrontation à la science et en particulier à l’histoire et à la pensée n’est pas l’art de tirer son épingle du jeu, d’user de dérobade pour se tirer d’affaire en retombant toujours sur ses pieds, en s’obligeant à des contorsions, à des circonvolutions de circonlocution, pour « sauver les apparences » comme on sauve la face. Il ne s’agit pas comme on le voit très souvent, à des fins de propagande religieuse, de badigeonner le dogme avec le langage de l’actualité scientifique, faire dans le grossier replâtrage ou gonfler les thèses scientifiques en baudruches, voire de les qualifier bruyamment d’antisémites (je pense au dénigrement systématique de ceux qui font de la critique biblique) pour se donner ensuite la gloire de les pourfendre, se tailler un succès personnel en réfutant des thèses jamais professées, etc.
Ajoutons qu’en amont de la question de principe, de jure – si pensée et histoire doivent-elles être étroitement mêlées à l’enseignement du judaïsme – se pose d’abord la question concrète, de facto : les mœurs et modes de pensée externes ont-ils effectivement influencé le judaïsme ? Voici le type même de question difficile voir impossible à poser dans certains milieux repliés sur eux-mêmes car la réponse à la question de départ – la discipline de l’histoire est-elle nécessaire – suppose que l’on doive utiliser cette discipline pour y répondre ! En effet, pour vérifier sérieusement si le judaïsme pensé et édicté par les rabbins à travers l’histoire a oui ou non été en interaction avec l’environnement social et intellectuel, il faut faire de l’histoire et notamment de l’histoire de la pensée ! Et là, toute enquête honnête montre que l’interaction en question est un phénomène massif. Je n’en donnerai qu’un exemple parmi des milliers : la « hassava » ou le fait de s’accouder à la table du seder de Pèssah. L’étude historique montre aisément qu’il s’agit là d’une coutume héritée de l’environnement hellénistique dans lequel la pratique était de prendre ses repas sur une litière, chacun ayant une petite table disposée devant lui (d’où le « plateau » du seder). Cette pratique a fini par être pleinement intégrée au sein des codes religieux du judaïsme. Son origine halogène n’enlève rien à sa pertinence symbolique. En effet, seuls les citoyens, hommes libres dînaient dans cette posture, non les esclaves, et tel est bien le message que l’on veut exprimer au soir du seder : l’affirmation de liberté. Était-ce trahir le judaïsme qu’avoir adopté de telles mœurs et coutumes ? Au contraire, c’était son actualisation.
Enfin, si derrière la question de la prise en compte de l’histoire, se pose la question de l’authentification des faits et notamment des connections et influences mutuelles entre civilisations, derrière la prise en compte de la pensée et de la science, se pose la question de l’autorité de la raison, de la logique de déduction mais aussi de l’analyse critique et comparative. Considérons brièvement ce mot si anxiogène et même hallucinogène : « critique ». Il ne signifie pas dénigrement, comme beaucoup se le figurent, mais discernement : avoir l’esprit critique, c’est refuser d’être dogmatique, de se soumettre aveuglément, c’est-à-dire refuser le lavage de cerveau, la pensée totalitaire. Ce n’est pas une apostasie même si l’on ne peut ignorer que toute remise en question ébranle forcément les certitudes et menace les convictions premières. Ne soyons pas faussement naïfs. Toute confrontation porte en elle le risque d’ébranlement. Ce n’est pas un hasard si certains d’entre nous préfèrent se nicher sous une gangue épaisse et hermétique, à l’abri du monde. Mais on ne peut rester calfeutré indéfiniment dans son bunker sous peine de suffocation. L’environnement est bien là et le défi sempiternel est de savoir si nous savons nous y intégrer sans nous désintégrer. Le risque d’ouverture est majeur mais vital. Gageons que si notre foi est consistante, elle n’a pas à craindre à s’exposer aux vents et marées. Mieux, le questionnement et la confrontation sont les outils indispensables qui forgent la foi, l’affûtent et l’acheminent vers la vérité et l’authenticité, comme le suggère un texte talmudique : « Rabbi Yanaï enseigne : Si la Tora avait été révélée tranchée [avec des normes figées], elle n’aurait pas eu pied pour se tenir debout [se maintenir]. Que cela signifie-t-il ? Moïse avait exprimé un souhait : “Maître du monde, révèle-moi la ligne de conduite à adopter”. Dieu lui répondit : “Il faudra trancher selon la majorité [du collège rabbinique]’’ (fondé sur Exode 23:2). Si ceux qui disent innocent ou autorisé sont majoritaires, la règle est selon eux. Si ceux qui disent coupable ou interdit sont majoritaires, la règle est selon eux. [La Tora a été donnée] de telle sorte qu’elle puisse être interprétée par quarante-neuf arguments en faveur de la pureté [d’une situation] et quarante-neuf arguments en faveur de l’impureté [de la même situation].” » (Talmud de Jérusalem, Sanhédrin 4, h.2). Établir la culpabilité ou l’innocence, la pureté ou l’impureté, est grave : la vie peut en dépendre ! Et pourtant, ce texte époustouflant proclame que seule la confrontation à toutes les facettes de cette réalité, multiples et contradictoires, établit la halakha , la norme à suivre. Non à partir d’un savoir purement théorique, préformaté, mais dans l’application à la réalité et par son évaluation !
En conclusion : La Tora n’est pas une vérité autonome idéalisée au sens platonicien, déconnectée de la réalité comme une tour d’ivoire. Tel est le sens profond de la conjonction : Torat haïm, « enseignement de vie ». La Tora est une sagesse qui porte sur le vivant. Elle doit être, selon l’expression talmudique, un « élixir de vie » (Taânit 7a). En cela, elle est sœur de la médecine. Un bon médecin ne dira pas à son patient qu’il n’est pas malade parce que sa pathologie n’est pas recensée dans son traité officiel de médecine générale ! Et s’il ne détient pas présentement de thérapie adéquate, il ne déclarera pas non plus que la médecine est inefficace. Mais il entamera des recherches pour déceler un remède nouveau et opératoire, jusqu’à guérison totale. La Tora est une sagesse qui porte sur des réalités en devenir : la société et l’histoire. Voilà pourquoi son secret et son art consistent à user des sciences pour articuler particulier et universel, norme et réalité, science et conscience. Selon le mot d’André Neher : l’hébreu est l’ivri, le passeur des mondes, celui qui doit permettre jonction et articulation, et c’est cette vertu exaltante que je nous souhaite à tous, lorsque nous nous prenons à rêver l’école juive de demain.