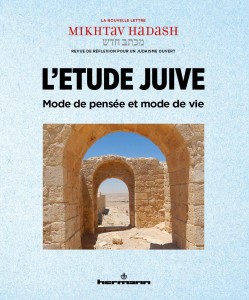Le film lui-même n’est pas génial, mais il permet de lever un voile sur un épisode peu connu. Il a également une vertu didactique importante par les temps qui courent où musulmans et juifs sont rejetés dans leurs antagonismes. Il prend cependant quelques libertés avec les faits historiques.
Film français de Ismael Ferroukhi avec Tahar Rahim, Michael Lonsdale, Christopher Buchholz, Youssef Hajdi, Mahmud Shalaby ... sortie en 2011
Le réalisateur
Né en 1962 au Maroc, fils d’un ouvrier travaillant dans une fabrique de cartons, c’est un autodidacte : ISMAEL FERROUKHl a d’abord été employé dans un élevage industriel de poulets avant de devenir, entre autres, scénariste pour Cédric Kahn ("Trop de bonheur", l’avion"...). Son film "le Grand Voyage" (2004) a reçu le lion du futur (meilleure première oeuvre) à Venise.
Une page d’Histoire
Avec « les Hommes libres » d’Ismaël Ferroukhi, c’est tout un pan de notre mémoire qui ressuscite. Et le choc est immense : cette fraternité des armes, cette main tendue par-delà les divisions communautaires, elle a donc bien existé. Le recteur Si Kaddour Ben Ghabrit (joué par Michael Lonsdale) a favorisé des filières, fourni des faux papiers, caché d’autres fils du Livre, tout en restant conciliant avec les autorités allemandes. Honneur, donc, à ces musulmans qui, aux heures sombres, ont su résister.
Le film commence en 1942. Alors que Younès, un jeune Algérien, pratique le système D, il est recruté par la police française, puis envoyé pour espionner la Mosquée. Là, il rencontre Salim, un chanteur nord-africain, et apprend que celui-ci, en réalité, est juif. Younès se confie alors au recteur Si Kaddour Ben Ghabrit, et se retourne : il bascule dans la Résistance et découvre les chemins du combat contre les nazis. Liberté, liberté chérie... Refusée par les Français, anéantie par les Allemands, quelle sera-t-elle, cette liberté, après la guerre ?
S’inspirant d’un article du « Nouvel Observateur », Ismaël Ferroukhi a mis au jour, avec l’aide de l’historien Benjamin Stora, cette histoire gommée. C’est toute l’originalité de ce film sensible et courageux : s’inspirant d’événements authentiques, « les Hommes libres » retrace l’itinéraire de gens considérés comme des sous-humains. Ces travailleurs immigrés, souvent illettrés, toujours maltraités, constamment humiliés, ont eu une dignité que beaucoup de « bons Français » ont piétinée. Ils sont restés des hommes, simplement des hommes, mais hautement des hommes.
Voici un entretien de l’historien Benjamin Stora paru dans le Nouvel Observateur.
Le Nouvel Observateur -
C’est une histoire totalement méconnue. Pourquoi ?
Benjamin Stora -
L’histoire des Algériens en France reste un point aveugle de notre histoire. Ce sont des hommes invisibles. En 1939, pourtant, ils étaient près de 100.000. La première vague, composée surtout de Kabyles, est venue après la Première Guerre mondiale.
On avait du mal à les répertorier puisque les Algériens n’étaient ni des étrangers, ni des sujets (comme les Marocains ou les Indochinois), ni des Français, puisqu’ils n’avaient pas la nationalité française. Sur le plan statistique, ils n’existaient pas. Les seules traces comptables se trouvent dans les registres portuaires, qui donnent une indication sur les flux migratoires.
Quel était leur statut ?
Pas de statut juridique précis. Main-d’oeuvre non qualifiée, écrasée socialement, au bas de l’échelle, c’étaient tous des paysans jetés dans l’univers industriel sans rien connaître des codes urbains. Ils habitaient, dans des conditions très misérables, des « garnis » qui tenaient du café, du bureau de placement, du lieu d’échange, de la place du village. Les hommes venaient en France sans famille, puis en repartaient un jour, ce qui les rendait encore plus invisibles. Aucun droit social, syndical ou politique. C’était une infra-humanité. On les nommait les « norafs ».
Quel était donc leur moyen d’exister, comme hommes ?
La lutte politique et syndicale. D’où l’importance d’une organisation créée en 1926, l’Etoile nord-africaine, sous la direction de Messali Hadj, qui militait pour l’indépendance. C’était la principale façon de s’affirmer à l’époque. Ce mouvement politique a participé aux grèves du Front populaire.
Ces hommes ainsi niés par l’Etat français, pourquoi s’engagent-ils contre les Allemands ? Par patriotisme ?
Attention ! Ils s’engagent dans la Résistance, pour une partie d’entre eux. Leurs motifs ne sont pas patriotiques ! Ils se situent dans une matrice culturelle et politique qui est celle du syndicalisme et du socialisme. Ils suivent une tradition ouvrière. Le Parti communiste, qui a au début participé à la création de l’Etoile nord-africaine, les regarde ensuite avec beaucoup de méfiance, voire d’hostilité. Parce que ces hommes veulent leur indépendance, refusent la tutelle du PCF. Ils sont donc des nationalistes, pas des internationalistes. Ils sont soupçonnés par le PC de faire le jeu des « puissances de l’Axe ». Ce qui est faux, évidemment.
Il y avait quand même l’exemple du mufti de Jérusalem, qui a constitué une division de Waffen SS et fréquentait Hitler.
C’est très différent. La plupart des dirigeants politiques nord-africains en France sont en contact avec les socialistes. Leur anticommunisme ne les pousse pas vers Jacques Doriot, mais vers Marceau Pivert. La majorité des immigrés de cette période, Polonais, Italiens, Espagnols, rejoignent le PC, via la MOI, l’Affiche rouge... Pas les Algériens. Du coup, les historiens français ont fait l’impasse sur ce mouvement.
Le PC, en 1939, avait pourchassé les militants algériens immigrés, un peu comme les trotskistes. De plus, Messali Hadj, le principal leader indépendantiste de l’époque, était proche du Poum espagnol [Parti ouvrier d’Unification marxiste], donc, aux yeux des communistes, quasiment un ennemi. Il y a bien eu des nationalistes algériens qui sont passés du côté de l’Axe, avec la formule « Les ennemis de nos ennemis sont nos amis ». Il y a eu aussi une brigade nord-africaine à Paris, rue Lauriston, qui s’est distinguée par sa cruauté. Messali Hadj, lui, était contre Vichy. Il a d’ailleurs écopé en 1941 de seize ans de travaux forcés. Il est resté trois ans dans un bagne pour avoir refusé la collaboration.
L’un des aspects les plus étonnants du film, c’est la bienveillance dont fait preuve le recteur de la Mosquée de Paris, Si Kaddour Ben Ghabrit, envers les juifs.
En effet. La Mosquée de Paris, c’est une histoire intéressante. Elle est fondée en 1926, en hommage aux soldats musulmans tombés pour la France. Si Kaddour est proche du sultan du Maroc, dans l’appareil diplomatique duquel il a travaillé. La Mosquée est donc un lieu institutionnel dont les immigrés se méfient dans les années 1930. Ils y vont peu. Mais elle va devenir un point de ralliement dès le début de la guerre, car on peut y trouver à manger, à se vêtir. Dès 1939, les hommes restés en métropole commencent à s’y rendre. Le recteur, lui, est nommé par la France. Il s’adapte. Il est très politique.
Dans le film, il dialogue avec les nazis et sauve des enfants juifs, en même temps.
Qu’est-ce qui s’est passé pour les juifs séfarades à Paris en 1940-1941 ? La plupart parlaient arabe. Ils étaient circoncis. Il était tentant, vis-à-vis des autorités d’occupation, de se faire passer pour des « mahométans » pour échapper aux rafes et aux arrestations. Direction la mosquée, donc, lieu de calme. Les juifs « mahométans » y écoutaient de la musique orientale et pouvaient y manger, certains qu’il n’y aurait pas de porc. Pour le recteur, ouvrir la mosquée aux juifs n’était pas une ligne politique. Ca s’est fait au hasard de rencontres et de nécessités. C’était une tolérance.
Inimaginable aujourd’hui.
Oui. Mais, à l’époque, les juifs séfarades et les Arabes évoluaient dans le même univers culturel. Il y avait un vieux fond d’hostilité ancestrale, certes, mais ils cohabitaient. Plus aujourd’hui. Il y avait aussi eu le pogrom à Constantine en 1934, avec beaucoup de morts, mais, malgré ces affrontements, juifs et Arabes partageaient dans l’espace public le même univers, les mêmes valeurs, les mêmes racines. Evidemment, pour le juif qui venait d’Odessa ou de Minsk, c’était différent...
De là à procurer des faux papiers à des juifs, à leur fournir des filières d’évasion, il y a un grand pas...
Dans le film, on voit le recteur écouter la radio et, en novembre 1942, il prend connaissance du débarquement en Afrique du Nord. Là, pour lui, tout change. Les Américains sont au Maroc. La collaboration, c’est fini. Une autre histoire commence. Donc, chez Si Kaddour, il y a une part de calcul politique, et, en plus, il n’est pas antisémite, pas du tout. Il est dans la tradition makhzénienne, celle de la protection donnée par le sultan. On protège les gens du Livre.
Il n’y a donc pas de planification, dans ce sens, à la Mosquée ?
Non. Ca s’est fait au gré des circonstances. Bien sûr, il y a des musulmans qui ont critiqué cette attitude. Et les Allemands ont joué sur ces dissensions. Mais ça n’a pas marché. Ainsi, malgré la propagande allemande, en Algérie, les gens ne se sont pas approprié les biens des juifs ! Mes grands-parents ont été expropriés par le régime de Vichy dans les Aurès, et ont pu récupérer leurs biens après la guerre.
Le recteur a-t-il été inquiété par les Allemands ?
Oui, en 1940, et en 1943 - une année difficile. En 1944, terminé. C’est vite passé. Après, en 1947, il a été décoré pour son attitude pendant la guerre. Il est mort en 1954. Il a été l’homme de la bienveillance.
Cette bienveillance a-t-elle disparu aujourd’hui ?
Non. Dans la société profonde d’Algérie, du Maroc, de Tunisie - je ne parle pas du discours étatique -, il y a toujours une forme de nostalgie de la présence juive. Les juifs étaient l’indice de la pluralité, cette pluralité qui s’est progressivement effacée dans le monde arabe.
Après la guerre, les Algériens résistants n’ont pas eu droit à la reconnaissance de la France ?
Non. Parce que, dans leur grande majorité, les immigrés algériens étaient des indépendantistes. Et, après le massacre de Sétif, en mai 1945, une histoire conflictuelle commence entre Français et Algériens.
« Les Hommes libres » est donc une réhabilitation tardive, mais nécessaire.
Je parle de ces événements dans mes ouvrages depuis trente ans. Pour moi, le film d’Ismaël Ferroukhi est surtout une reconnaissance de toute cette histoire.
Propos recueillis par François Forestier
Source : "le Nouvel Observateur" du 22 septembre 2011.
Mais aussi collaboration
Voici une mise au point sur certaines pratiques administratives de la part de la Mosquée, qui montre que tout ne fut pas blanc et que des zones d’ombre persistent. Par Jean Laloum, chercheur au CNRS, groupe Sociétés, religions, laïcités.
Le film d’Ismaël Ferroukhi, Les Hommes libres, est un beau film plein d’humanité, mettant en scène – dans le Paris occupé –, un épisode de la Mosquée de Paris. Afin de pallier le petit nombre de documents traitant du sujet, le réalisateur a choisi de conjuguer fiction et sources historiques dans l’écriture du scénario. D’entrée de jeu, le spectateur est prévenu du mélange des genres, non de leur part respective.
Au cœur de l’intrigue, le "planquage" d’enfants juifs dans la mosquée-même et le subterfuge utilisé pour soustraire le chanteur juif natif d’Algérie, Simon – alias Salim – Halali aux desseins allemands et vichystes. La délivrance de faux papiers, l’inscription apocryphe du nom du père du chanteur bônois sur une pierre tombale du cimetière musulman de Bobigny, parviennent à contrecarrer le sort qui leur était réservé.
Très tôt pourtant, les autorités allemandes suspectant le lieu de culte de collusion y enquêtent. Dès septembre 1940, bien avant la création du Commissariat aux questions juives (CGQJ), Vichy est prévenu de ses possibles agissements : "Les autorités d’occupation, révèle une note interne au ministère des affaires étrangères, soupçonnent le personnel de la mosquée de Paris de délivrer frauduleusement à des individus de race juive des certificats attestant que les intéressés sont de confession musulmane. L’imam a été sommé, de façon comminatoire, d’avoir à rompre avec toute pratique de ce genre. Il semble, en effet, que nombre d’israélites recourent à des manœuvres de toute espèce pour dissimuler leur identité." Quelles institutions furent à l’initiative de la délivrance de faux certificats ? Quels furent les moyens de contrôle des services de Vichy en vue de déjouer ces pratiques ? Que penser de l’attitude prêtée au directeur de la Mosquée de Paris à partir d’un nombre réduit d’indices ?
Son rôle, à la lumière d’autres archives, semble plus ambigu qu’il ne ressort du film.
Les attestations de complaisance circulent en nombre dans la France occupée. Au sein de l’imposante série AJ38 répertoriant les archives de l’ex-CGQJ conservées aux Archives nationales, les certificats de baptême, d’initiation ou d’ondoiement, de mariage ou d’inhumation adressés par les autorités religieuses à des familles présumés juives, y figurent très régulièrement. Ceux-ci proviennent pour l’essentiel de la sphère chrétienne. S’ils sont adressés au CGQJ, c’est que celui-ci tient un rôle primordial dans la reconnaissance raciale des individus. C’est en effet l’une de ses directions – la direction du Statut des personnes – qui, par ses avis autorisés, entérine la décision. Un certificat de non-appartenance à la race juive (CNARJ) est alors délivré à la personne ayant fourni toutes les pièces justificatives de son aryanité.
Une fois épuisées les possibilités de se procurer ces attestations religieuses, c’est en dernier recours le diagnostic du professeur George Montandon, expert "ethno-racial" à la solde des Allemands qui détermine, après examen, l’identité raciale de l’individu. Il se targue d’une connaissance quasi universelle sur les religions. Or, pour nombre de juifs d’origine nord-africaine justement, revêtir l’identité d’un Arabe de confession musulmane constitue un subterfuge courant. La langue arabe, longtemps langue vernaculaire de ce judaïsme d’outre-Méditerranée, est encore couramment pratiquée dans les familles installées en France. Du coup, c’est d’instinct que ceux-ci jouent sur l’ambiguïté, aussitôt qu’ils sont menacés.
Très tôt cependant, le CGQJ s’avise de débusquer les fraudeurs. La direction du Statut des personnes s’adjoint d’experts pour transcrire et authentifier les certificats en langues étrangères qui lui sont soumis. Elle fait également appel à la collaboration des différents représentants religieux pour évaluer, par des avis étayés, les déclarations des postulants se réclamant de la race aryenne, même si elle soupçonne ces religieux de se prêter à des conversions de complaisance. Ne pouvant se passer d’eux, elle les sollicite, quoiqu’avec la plus grande défiance. Les autorités musulmanes constituées sont donc périodiquement consultées pour statuer sur les requérants se réclamant de la religion musulmane.
L’onomastique, le lieu de naissance et la filiation sont les critères retenus par la direction du Statut des personnes pour déterminer la race, car la circoncision, pratiquée également par les musulmans, n’est pas un indice probant dans le cas des juifs nord-africains. Une note du CGQJ adressée le 14 septembre 1943 au directeur de l’Institut musulman – mosquée de Paris demande son avis "sur le patronyme de Amsellem Salomon, Yacouta née Ben Rhamin Bent Chemoun et enfin : Ben Aroch Messaoudah. […] Je vous demanderai également de bien vouloir me dire si ces noms vous semblent être ceux que portent les musulmans ou les arabes, et si, selon votre sens, les juifs d’Algérie peuvent porter ces mêmes noms. Une prompte réponse de votre part m’obligerait." Le 23 septembre suivant, une même demande concernant un individu natif de Guelma, Joseph Krief (ou Kriel) qui, s’étant déclaré juif par erreur alors qu’il serait musulman, souhaiterait revenir sur cette première déposition. De façon inattendue, la direction laisse la Mosquée de Paris libre d’invoquer l’incertitude, ce qui jouera au bénéfice de l’examiné. Le verdict, cinglant et circonstancié, tombe comme un couperet moins de deux semaines après : "L’Institut Musulman à qui j’avais soumis aux fins d’authentification le document que vous m’avez communiqué, vient de m’indiquer que votre nom était un nom juif algérien. Le nom de votre père, Vidal Kriel, confirme cette origine..."
Ces demandes d’expertise auprès de la Mosquée de Paris n’ont rien d’exceptionnel. Ces échanges sont répétés, sinon réguliers. Le 17 juin 1944 une nouvelle requête est adressée à Si Kaddour Ben Ghabrit au sujet de la position raciale de Germaine Roland, née Marzouk, originaire de Tunisie : "Vous avez eu l’amabilité, à diverses reprises, de me donner votre avis sur des cas d’espèce analogues à celui-ci, lui écrit-il. Puis-je vous demander à nouveau de me faire savoir si l’attestation dont il s’agit peut être tenue pour valable ou non et si les patronymes des ascendants de l’intéressée sont d’origine juive ou musulmane […]." Le 12 juillet 1944, le CGQJ avise le mari de l’intéressée qu’en vertu des conclusions convergentes de la Mosquée de Paris et de l’"expert ethno-racial" George Montandon, Germaine Roland sera considérée comme juive au regard de la loi du 2 juin 1941. Transférée le 5 août 1944 du camp de Bassano à celui de Drancy, elle n’évite la déportation qu’en raison de la date tardive de son internement.
(Point de vue paru dans Le Monde du 07.11.11)