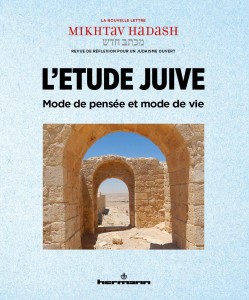Et que devient cette langue maternelle, si soigneusement oubliée ou si violemment éradiquée, selon les cas ? Un souffle, une pulsation secrète au creux d’un poème écrit dans la langue apprise. Et parfois, un sanglot.
Nurith Aviv, documentariste israélienne, a la passion des zones grises, situées entre ce que l’on montre en public, et ce que l’on ressent (cf. deux de ses documentaires précédents : Circoncision, en 2000 ; Makom, Avoda, en 1997). Pourquoi ? Dans son dernier film, la cinéaste nous livre peut-être la clef de son moteur de création car elle aussi a vécu, à travers ses parents, le décalage entre la langue maternelle tombée en disgrâce dès leur arrivée en Israël, et la nouvelle langue, balbutiante puis plus assurée, mais restée pauvre en tant que source d’émotion.
Neuf personnes se livrent au regard complice de sa caméra. Leur commun dénominateur est d’avoir appris l’hébreu comme langue seconde - ou de le vivre en décalage par rapport à la culture familiale - tout en exerçant une activité artistique ou intellectuelle liée à la langue, au langage : écrivain, poète, chanteur, acteur, rabbin . Pour parler l’hébreu, ou plutôt pour vivre en hébreu, les personnes interrogées ont dû, consciemment ou non, se défaire de leur langue maternelle jusqu’à l’oublier, de peur qu’elle ne vienne brouiller leur vie, leur expression, leur création. Meir Wieseltier, l’un des témoins, ira jusqu’à qualifier cet acte d’assassinat.
La langue apprise nous procure-t-elle le même confort, la même sensation de fluidité, de naturel, que la langue maternelle ? Circule-t-elle dans le même sens ? “Ma langue maternelle (l’allemand NDLR)), confie Aharon Appelfeld (et à travers la caméra, c’est au fond de chacun d’entre nous qu’il regarde), coulait de source, librement, naturellement. Apprendre et parler l’hébreu, c’était se remplir de gravier.” Source jaillissante d’une part, absorption de matière indigeste de l’autre, la métaphore est lourde de sens… Et pourtant, l’écrivain déclare qu’en fin de compte, il ne possède plus qu’une langue, l’hébreu – qu’il a parfois peur de perdre.
Mais que devient celui qui ne procède pas à ce choix radical ? Il semble devoir rester dans un éternel no man’s land, flottant à la dérive. La seconde langue n’acquerra pas pour lui l’intimité, la sensualité intrinsèque, le pouvoir évocateur des mots que seule une langue première, maternelle, semble pouvoir posséder.
Haïm Uliel, chanteur de variétés né en Israël de parents marocains, a mis des années à admettre que l’impact de sa musique était très différent selon la langue employée. “Prenons l’expression « eli khabibi », en hébreu, ce n’est pas très sexy, vous ne trouvez pas ? Alors que la même phrase en arabe « eli khbibi » a une charge émotive, érotique, qui fait vibrer le public...” Uliel a fini par s’affranchir de la honte qui pesait sur l’utilisation de la langue maternelle lorsqu’il était enfant, pour faire alterner, dans ses chansons, l’arabe et l’hébreu.
Daniel Epstein, rabbin et philosophe, avoue quant à lui être sans cesse sur le fil du rasoir entre le français et l’hébreu, ses deux univers conceptuels si distants l’un de l’autre… Comment se départager entre les perches qu’ils lui tendent simultanément ? Le mot hébreu rakout, par exemple, ne le caressera jamais comme sait le faire son équivalent français, tendresse. Pris au piège de la comparaison, Epstein court éternellement d’un monde à l’autre… Et d’une langue à l’autre.
"Misafa Lesafa" de Nurith Aviv est disponible en DVD : Swan Productions
Héléna Fantl