Préface du rabbin Rivon Krygier
Avec l’édition du présent sidour (livre de prières), voilà un vieux rêve qui s’accomplit enfin.
Notre ambition fut de relever la gageure : maintenir les acquis d’une liturgie accessible et participative tout en restituant l’essentiel de la trame liturgique.
Il s’agissait également de remettre l’hébreu à l’honneur, fibre sacrée de la civilisation juive, tout en permettant aux fidèles de comprendre et suivre les offices. L’enjeu n’était pas moins que celui d’inventer une expression médiane dans le paysage des synagogues, en se dotant d’une manière de prier qui soit tout à la fois résolument moderne et traditionnelle.
Que d’efforts consentis et de temps arraché à mille et une autres tâches pour que ce sidour voie le jour. Le sidour américain Sim Shalom du mouvement conservative a servi de canevas à cet ouvrage qui pour l’essentiel en suit la conception, mais en ajoutant plusieurs spécificités françaises et notamment séfarades.
Il couvre non seulement l’ensemble des offices de Chabbat et de fêtes de pèlerinage (Pèssah, Chavouôt et Souccot ) mais également les rites domestiques essentiels qui accompagnent ces célébrations telles l’allumage des bougies, le Kiddouch , les chants (zemirot), les bénédictions des repas, la cérémonie de clôture (havdala ).
Il comprend, outre une traduction modernisée et plus proche de l’hébreu, diverses explications sur le sens et des instructions pratiques sur le déroulement de l’office, la référence des versets bibliques cités, le nom des prières.
Il intègre autant que faire se peut des formulations importantes du rite sépharade (Kaddich , Kedoucha , Havdala , etc.).
Il comporte enfin une translittération (phonétique) des passages les plus déclamés ou chantés afin d’y associer les néophytes de l’hébreu.
Reconnaissons-le : la prière est pour beaucoup d’entre nos coreligionnaires d’aujourd’hui chose difficile voire insipide.
Peut-on pénétrer dans l’antre de la synagogue en laissant au vestiaire les états d’âme autour de la croyance qui bien évidemment questionnent le sens même de l’acte qui consiste à s’en remettre à Dieu, à se livrer à louanges et célébrations diverses ? Et quand bien même, foi et piété habitent les cœurs, combien d’entre les visiteurs non-avertis sont-ils à même de rester concentrés durant des heures sur un texte en hébreu qu’ils entendent mal ou aucunement, de suivre des scansions à rythme soutenu, sur des mélodies peu connues ou mélopées confuses ?
Sans vouloir me montrer trop sévère, il nous faut avouer que même chez les fidèles d’entre les fidèles trop souvent l’esthétique, l’émotion, le recueillement pour ne pas oser dire la ferveur ne sont pas suffisamment au rendez-vous.
L’exercice en soi n’est pas facile.
La liturgie est une trame dont il faut pouvoir se défiler ! Souvenons-nous de l’enseignement des maîtres du Talmud . Rabbi Chimôn disait : « Sois attentif lors de la récitation du Chemâ et de la âmida (prière) ; et lorsque tu pries, ne fais pas de ta prière une litanie, mais une sincère supplication adres¬sée au Créateur » (Avot 2:18).
Ou encore : « En quoi consiste la prière ? Elle est « âvoda chè-ba-lèv », le culte accompli dans le cœur » ou selon une autre lecture, « travail dans/sur le cœur » (Mekhilta de-Chimôn bar Yohaï 23:25).
Il y aurait beaucoup à dire sur ce que nous parvenons déjà et malgré tout à faire et sur ce qu’il conviendrait de faire plus encore – l’enjeu spirituel – pour redonner tout l’éclat et toute la profondeur que la prière juive recèle.
Mais puisque notre tâche consiste également à tenter de lever les inhibitions et préjugés de ceux qui se détournent de la synagogue, je me propose d’esquisser quelques réflexions sur le sens même qui consiste à se rendre régulièrement aux offices pour partager l’expérience de la prière.
Au fond, que venons-nous chercher à la synagogue ? Précisément, ce sur quoi nous buttons. La liturgie charrie la mémoire vivante de la spiritualité de notre peuple dont nous avons été en bonne part aliénés. La destruction du Temple, l’exil, les persécutions, la déliquescence identitaire et l’oubli ont semé le néant et la désolation. L’ombre de la Choa plane encore sur nos générations.
Toutefois, confusément mais résolument, notre peuple n’a jamais rompu avec cet héritage, ce formidable gisement de formules qui recèlent sa vision de l’homme transfiguré au contact de Dieu.
Oui, même confusément, même quand tel contenu de foi ou tel rite paraissent incongrus ou désuets aux plus sceptiques et désabusés d’entre nous, nous savons que nous ne savons pas, que quelque chose d’essentiel nous échappe, que ce qui nous est insaisissable mérite d’être préservé, percé, exploré.
Combien saisissant est le ravissement de ceux qui au détour d’un enseignement, d’une mélodie, d’un recueillement renouent avec ce qu’ils croyaient perdu à jamais.
L’âme s’éveille de sa torpeur, se joint au chœur, rencontre des significations et des vibrations qu’elles ne soupçonnaient pas.
À la synagogue, nous nous retrouvons… Elle devient alors le lieu où s’opère un recentrage là où la vie nous avait poussés au dehors, loin de ce socle de valeurs, loin de cette terre féconde, terre de notre esprit exilé. L’instant du rendez-vous, du rassemblement communautaire (synagogue en hébreu se dit beit-knèssèt, lieu de rassemblement), nous reformons le tissu social qui s’était distendu ou disloqué, nous unissons nos voix dans ce dialogue éperdu avec l’absolu pour y puiser les ressources mêmes qui fondent l’existence et la vocation de notre peuple.
C’est en éveillant à nous-mêmes et en transmettant cette mémoire à nos enfants que nous nourrissons notre et leur avenir. L’amnésie, c’est le néant, le nihilisme. Car ce que véhicule la prière, ce sont des valeurs éternelles dont nous sommes dépositaires mais oublieux.
Aussi ce ressourcement nous régénère, rafraîchit et ravive nos consciences, nous rattache à notre identité profonde. Nous perçons le présent fugace pour nous inscrire dans l’histoire sainte, la chaîne des générations, celle du projet divin de voir s’humaniser l’homme à l’image de Dieu, à Sa ressemblance.
Mais qu’entend-on par « dialoguer » avec Dieu ? Nous, Juifs, sommes plutôt prolixes. La loi rabbinique a instauré de multiples occasions au cours desquelles nous sommes censés nous adresser à Dieu et plus généralement, proférer des « paroles saintes ».
Nous sommes amenés quotidiennement à réciter bénédictions et louanges, à relire de nombreux psaumes comme autant de références liturgiques anciennes qui nous relient au grand réservoir de la mémoire collective. Nous citons et récitons inlassablement les Écritures saintes, pour vivre d’elles et avec elles en symbiose.
C’est en cela que l’expérience de la communion synagogale recouvre bien les deux sens éthymologiques possibles du mot « religion ». Le plus connu est que le latin religio renvoie à religare qui signifie « relier ». Mais à en croire Cicéron, religio pourrait provenir aussi de relegere qui signifie « recueillir » ou « relire ». Cela, me direz-vous, est universel. Oui, sauf qu’à la synagogue, c’est de notre religion dont il est question vitale.
Et puisque nous en sommes à préciser le sens originel des termes, observons que toutes ces paroles religieuses concentrées pour l’essentiel en trois offices quotidiens et que le commun des fidèles a pris l’habitude d’appeler « prière » ne sont pas ce que la tradition rabbinique appelle à proprement parler la prière : tefila.
Certes, même en hébreu, ce vocable a fini par constituer un terme générique désignant toute parole proférée à des fins religieuses. Mais au sens premier, il désigne le moment précis où nous nous tenons face à Dieu, lorsque nous le sollicitons, Lui adressons une requête, Le priant... de réagir. Or ce moment privilégié doit être perçu comme exceptionnel. Je veux dire que la plupart du temps, lorsque nous, Juifs, prions au sens général, nous ne prions pas à proprement parler. En ce sens que nous ne demandons rien à Dieu mais au contraire nous nous en faisons les porte-paroles, les véhicules de la parole divine dans le monde, en propageant les enseignements de sagesse et la bénédiction qui proviennent de la source, à savoir de Dieu. Nous agissons en somme comme des courroies de transmission.
Ainsi quand nous énonçons la bénédiction dite du pain ou du vin, nous n’opérons pas ce qu’on appelerait un sacrement qui conférerait à l’objet béni un statut suréminent ou sacré. Ce n’est en fait ni le pain ni le vin qui se trouvent “bénis” mais Dieu Lui-même qui est reconnu comme source de bénédiction de sorte que le fidèle qui accomplit la bénédiction prend acte et conscience de la puissance agissante de Dieu dont le produit est en l’occurrence la jouissance du pain et du vin.
Je veux dire par là que le fidèle qui profère une bénédiction ne fait rien d’autre que relayer l’agir divin et par là même, contribue à l’effusion et la profusion de la bénédiction divine. C’est la fameuse prophétie adressée à Abraham, et corollairement à Sara, qui fut le coup d’envoi du monothéisme universel : « Tu seras bénédiction ; et en toi seront bénies toutes les familles de la terre… » (Gn 12,2-3).
Le centre de gravité du culte consiste donc en ce que Dieu demande à l’homme de se mobiliser et de se transfigurer plutôt que l’inverse, à savoir que l’homme demanderait à Dieu d’accomplir le salut ou la transmutation des objets du monde. Une preuve éclatante de cette conception ressort de l’historique de la prière juive. Les traces les plus anciennes de culte, telles qu’elles sont rapportées dans la Michna (Tamid 5,1), indiquent que dans le Temple, c’est la récitation dans la Tora des dix commandements et du Chemâ Israël qui accompagnaient en premier le sacrifice perpétuel.
À la racine du rituel juif apparaît donc le devoir de s’imprégner du Texte (l’étude) qui enjoint d’accomplir la volonté de Dieu, et non la prière qu’Il accomplisse la nôtre. L’invocation de Dieu se plaçait en second et se limitait à trois courtes bénédictions décrivant l’action bénéfique de Dieu : « qui jadis rédima le peuple, qui agrée le culte des sacrifices, qui répand la paix. »
Dialoguer avec Dieu signifie donc avant tout le fait de capter le verbe divin à travers notre tradition. Et en ce que celle-ci est sans cesse discutée et scrutée pour en révéler la pertinence et la mettre en adéquation à la réalité, nous discutons avec Dieu.
Mais qu’en est-il du sens premier du mot « prière » ? La toute première fois dans la Bible où l’on voit un personnage non pas seulement adresser la parole à Dieu au sens le plus large mais Lui exprimer une requête portant sur l’agir de Dieu, c’est lorsque Abraham implore la pitié divine pour les villes de Sodome et Gomorrhe (Genèse 18). Il Lui demande d’intervenir ou plus exactement d’interférer, de contrevenir à Lui-même, en l’occurrence de reconsidérer la résolution d’anéantir ces villes jugées perverses. Seule la familiarité avec le récit peut faire oublier l’incroyable outrecuidance qui consiste à vouloir s’immiscer, s’ingérer dans une décision divine au point de la contester.
Abraham se livre même à un véritable marchandage lorsqu’il suggère à Dieu que la présence plausible de cinquante justes au sein de ces villes mériterait que soit résilié le décret d’éradication. Et à peine Dieu lui concède-t-il cette grâce, qu’Abraham poursuit de plus belle invoquant la présence de seulement 45, puis 40, puis 30, puis 20, pour s’arrêter au quorum jugé minimal et fatidique de 10… Mais pourquoi s’arrête-t-il ? C’est que cette « imploration » se présente comme une demande de grâce et non d’amnistie qui serait comme une amnésie, oublieuse des forfaitures.
Abraham se donne pour tâche d’augmenter la part de miséricorde dans le verdict divin mais ne va pas jusqu’à supplier Dieu de renoncer à Son exigence de justice, à l’intégrité requise pour que la société demeure humaine. Il faut au moins dix justes. La grâce n’est donc possible que si elle s’appuie sur un socle de justice. En dépit de tout, doit subsister une part intacte d’humanité tant chez ceux qui sont objets de la prière que chez celui qui l’élève. Là encore, la pertinence du discours est liée à l’effort humain. Sauf qu’ici, il ne s’agit plus de diffuser l’action divine mais de la canaliser, en appelant Dieu à modifier le cours des choses et la teneur des décrets.
C’est là un des sens sous-jacents les plus édifiants de ce qui caractérise la conception juive de la prière. En hébreu, prier se dit « lehitpallèl ». Or la racine de ce verbe est « pallol » qui signifier « juger ». C’est au premier chef invoquer Dieu en tant que justicier. Mais la forme réflexive du verbe laisse entendre que prier signifie aussi se placer en situation de mise en examen, comme si nous comparaissions devant le tribunal de Dieu et de notre propre conscience. De sorte que l’efficacité de la prière dépend étroitement du verdict et de la disponibilité du juge suprême à la clémence. Or nous l’avons vu, celle-ci dépend corollairement de la justesse de la cause et de la dignité ou du mérite du sujet qui élève sa prière.
C’est il faut l’avouer une situation à la fois très délicate et très indélicate ! Car requérir de Dieu qu’Il se place en juge, se présenter à Lui au nom de son degré de droiture, en détenteur d’une sorte de faire-valoir qui confère gain de cause, peut relever d’une prétention inouïe qui frise une fois de plus l’arrogance. La Tradition juive ne confesse-t-elle pas avec l’Ecclésiaste (7,20) : « qu’il n’est point d’homme sur terre qui agisse uniquement dans le bien sans jamais pécher » ? Restons humbles.
Dans la pensée talmudique, malgré la reconnaissance du rôle déterminant du libre arbitre et de l’accomplissement des bonnes œuvres, subsiste l’idée que l’homme a besoin de l’assistance divine pour vaincre son « mauvais penchant ». Mais c’est précisément dans cette dimension auxiliaire que réside la clef de la prière. Dieu demande aux hommes d’être Ses partenaires, Ses interlocuteurs.
Si l’homme remplit sa part, Dieu remplit la Sienne et lui sera une « aide » : « Lève-Toi et viens-nous en aide, et libère-nous, au nom de Ta clémence » (Ps 44,27). Ce n’est pas tant le secours mais le concours divin que nous implorons à travers nos prières.
Selon la formule talmudique : « Rabbi Chimôn ben Lakich enseigne : Que signifie le verset : ‘‘Aux cyniques, Dieu répond par la raillerie, et aux humbles, en accordant Sa grâce’’ (Pv 3,34) ? Celui qui vient pour se souiller, une voie lui est ouverte ; celui qui vient pour se purifier, une aide lui est apportée » (Chabbat 104a). C’est dire que l’homme qui se présente devant Dieu, à défaut d’être un « juste », doit à tout le moins se munir de cette aspiration pour entrer dignement en dialogue, en « interaction » avec Dieu.
Prier, c’est d’abord attendre de soi. On ne doit donc jamais s’en remettre totalement à Dieu. Ce serait démission. C’est par synergie, par association, que la prière se transforme en résultante et devient « efficace. » Abraham n’a osé « négocier avec Dieu » à Sodome et Gomorrhe que très précisément parce qu’il était habité par l’intime conscience de ce que Dieu attend de lui, à savoir qu’il se fasse héraut de la justice et intercesseur des hommes au nom de cette justice.
Si Abraham se permet d’interpeller Dieu en Lui disant : « Est-ce que le juge de toute la terre ne ferait pas justice ? » (Gn 18,25), c’est dans l’exacte mesure où Dieu l’a investi de ce devoir d’humanité en lui révélant quelques instants plus tôt la raison de son élection : « Je l’ai choisi pour qu’il observe la voie de l’Éternel qui requiert d’accomplir justice et équité » (Gn 18,19).
Si donc le dialogue avec Dieu comporte la demande de grâce, c’est à la condition de ne jamais abandonner la quête de justice et d’amour, de ne jamais renoncer à l’effort de se bonifier. Le dépassement de soi est bien le secret de la prière enseigné par Abraham. Au fond, ce que nous dit le récit biblique, c’est que Dieu était disposé à outrepasser Sa propre colère, Sa propre rigueur, à remettre en cause Ses décrets en raison de l’intervention compatissante d’Abraham.
Et si Dieu est disposé à Se dépasser, l’homme le doit, à son tour, à plus forte raison. L’un induit l’autre. Un enseignement talmudique rapporte non sans un certain humour que Dieu chaque jour prie ! Alors, à qui donc S’adresse-t-Il ? On serait tenté de répondre : « à l’homme ».
Mais pour cela Dieu ne prie pas, Il ordonne. Non pas, nous dit le Talmud , Il S’implore Lui-même, disant : « Que ce soit Ma volonté que Ma miséricorde domine Ma colère de sorte que Je puisse Me conduire avec Mes enfants dans l’amour et la grâce » (Berakhot 7a). Alors, si telle est Sa volonté, béni soit-Il, qu’attend-Il ? Que nous soyons pleinement attentifs à Sa prière, comme nous espérons qu’Il le soit à la nôtre.
Rivon Krygier, veille de Pèssah 5767
Acheter le siddour Massorti
Il coûte 25€ + frais de poste.
Pour passer commande : contactez-nous par e.mail sur le lien suivant : Massorti
Vous pouvez également vous le procurer directement auprès d’une de nos communautés.








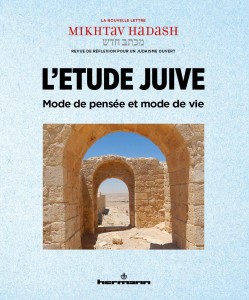


Messages
je souhaiterai avoir la paracha matot en phonétique,
pour pouvoir aider mon fils à réviser pour sa bar-mitzva,merci.
bonjour rabbi
je désire acheter le Sidour Massorti pour commencer l’étude et la pratique ; mais le lien ci dessus ne me donne rien et me ramène a une page vide. Pouvez me dire comment me le procurer et la manière de payer le prix du sidour . De plus s’il me faut d’autres livres de prières je vous prie de m’en signaler les faits. En vous remerciant d’avance rabbi.
Respectueusement
maurice P.
j’ai le meme probleme que Maurice P. pour le siddour