Oui, il est possible de traduire un texte sacré, on l’a fait et on ne cesse de le faire pour la Bible, le Coran, les Vedas et bien d’autres écrits encore ; ne dit-on pas même que la Bible est le texte le plus traduit (en plus de 2300 langues) sinon le plus lu ?
Non, une traduction n’hérite pas du caractère sacré de l’original, même si le temps l’a rendue aussi vénérable que la “ King James’ version ” ou si l’auteur en est un illustre réformateur comme Luther. “ Quelle est la meilleure traduction française de la Bible ?”, me demande-t-on souvent, ce qui suscite toujours en moi le même embarras. Qu’entend-on par “meilleure” ? la plus littérale ? la plus littéraire ? Ce que l’on demande en réalité, c’est la plus fidèle sans se douter des difficultés qu’implique cette notion, car quand bien même le traducteur voudrait-il rester le plus près possible de l’original, quand bien même voudrait-il ignorer tous les commentaires surajoutés qui, à son insu parfois, guident sa propre lecture, il devra trancher là où il ne comprend pas, là où nul ne comprend, pour offrir un texte lisible à son lecteur. Il reste que les traductions dans une même langue sont parfois assez éloignées par la syntaxe, le choix des mots, et que nul n’aurait l’idée de les commenter littéralement. L’exégèse ne s’applique qu’à un texte déjà sacré et aucune traduction moderne ne peut revendiquer ce titre.
À ces deux questions, il a été répondu bien différemment deux ou trois siècles avant l’ère courante, comme nous le verrons en examinant la Lettre d’Aristée à Philocrate qui est censée nous rapporter les circonstances dans lesquelles la Bible – ou plus exactement ses cinq premiers livres, la Torah – aurait été traduite en grec à Alexandrie.
La Lettre d’Aristée
Rappelons ici brièvement le contenu de cette “lettre” dont la forme épistolaire est de toute évidence fictive, dont l’auteur n’est pas un Grec du nom d’Aristée et dont le destinataire est probablement imaginaire. Il y a beau temps en effet qu’ on a décelé sous ce genre conventionnel d’époque hellénistique un écrit apologétique dû à un Juif d’Alexandrie. L’époque de sa rédaction est discutée ; on en abaisse souvent la date au IIème siècle avant l’ère commune. Sans accepter la fiction qui la situe au début du règne de Ptolémée Philadelphe (-285-246), je préfèrerais, pour ma part, la placer à la fin du IIIème siècle, car elle reflète une situation où la Judée était encore sous le contrôle des Lagides (donc avant –200), où l’institution sacerdotale était ferme (donc avant –175), et où l’Idumée n’avait pas encore été annexée à la Judée (donc avant –146).
Le Pseudo-Aristée rapporte comment il a été chargé par le roi Ptolémée II Philadelphe d’une importante mission et s’ en est bien acquitté. Il s’agissait d’enrichir la fameuse bibliothèque d’Alexandrie récemment fondée. Sur le rapport de son bibliothécaire Démétrios de Phalère, le roi décide d’y intégrer “les lois des Juifs”, mais pour cela il faut les traduire en grec. Une délégation grecque , dirigée par Aristée et son collègue André, se rendra donc à Jérusalem, chargée de nombreux présents pour demander au grand prêtre de choisir les traducteurs qui manquent dans l’Egypte lagide. C’est l’occasion pour Aristée de décrire la Judée et Jérusalem (100-118), l’ éblouissant vêtement cérémoniel du grand prêtre (§96-99), ainsi qu’ un étonnant système d’adduction d’eau souterrain menant au Temple (§88-91). Il y ajoute un bref exposé du monothéisme juif et des règles alimentaires (§128-171) qu’ il tient de la bouche même du grand prêtre. L’équipe des traducteurs choisis, six par tribu, soit soixante-douze, est reçue par le roi d’Egypte avec empressement. Un banquet de sept jours, conforme à leurs lois, est organisé en leur honneur : ils parlent chacun à leur tour, dix les premiers soirs, onze les deux derniers soirs et donnent, par leurs réponses aux questions royales sur l’art de gouverner, l’occasion d’admirer leur sagesse. Ils sont enfin installés au calme dans l’île de Pharos où ils se mettent à l’œuvre de la traduction, tous ensemble de concert. Leur travail est achevé en soixante-douze jours. La traduction donne lieu à une proclamation publique, elle fait l’admiration du roi, de son bibliothécaire et des Juifs de l’endroit.
Telle est donc la trame générale d’un écrit, de toute évidence imprégné de légende où certains ont voulu voir, en raison de l’ énorme place donnée au banquet philosophique (§187-300), un traité hellénistique sur la royauté remanié et fusionné avec des traditions juives alexandrines. Un examen plus attentif de ce texte nous montre qu’ il s’efforce aussi de répondre aux deux questions fondamentales posées dans cet article.
Avait-on le droit de traduire ?
Cette question qui aurait dû être préalable à toute l’entreprise n’intervient que tardivement et sous une forme voilée dans la Lettre. Une fois la traduction proclamée à l’émerveillement de tous, le roi demande à son bibliothécaire : “ Comment se fait-il que pareils chefs-d’œuvre n’aient jamais été l’objet d’une mention chez aucun historien et aucun poète ? ” (§312). On reconnaît là l’embarrassante question que les Grecs posaient aux Juifs quand ceux-ci affirmaient l’antiquité de leurs traditions ; c’est l’objection à laquelle devait plus tard tenter de répondre Flavius Josèphe dans son Contre Apion (I, 218) en citant tous les auteurs, grecs ou non , qui ont parlé des Juifs.
La réponse de Démétrios de Phalère au roi se situe sur un autre plan : “ En raison du caractère auguste de cette Loi et parce qu’elle vient d’un dieu ”. C’est bien reconnaître là que le transfert d’un écrit sacré vers un monde profane, païen de surcroît, posait problème. Il constitue même un sacrilège susceptible d’attirer un châtiment divin. Démétrios croit en effet savoir que deux auteurs grecs, de peu antérieurs (vers –300), Théopompe disciple d’Isocrate, et le poète tragique Théodecte, qui avaient chacun osé simplement insérer des citations bibliques en grec dans leur œuvre, furent atteints de maux soudains, le premier de troubles mentaux, le second de cataracte. Ces deux auteurs avaient d’ailleurs sans hésiter identifié la cause de leur mal puisqu’une prière à Dieu suffit à les guérir. L’explication donnée en songe à Théopompe est claire : “ C’était dû à l’indiscrétion qu’il avait eue de vouloir livrer les choses divines à des profanes ” (§315).
La traduction de la totalité des cinq livres de Moïse en grec pouvait constituer un cas plus grave que celui de ces deux précurseurs malheureux. Quelle que soit la véritable raison sous-jacente à cette traduction– besoins d’une communauté juive en cours d’hellénisation ou volonté royale de disposer des textes de lois propres aux diverses populations du royaume afin de juger celles-ci selon leurs législations respectives – , la question du sacrilège restait posée.
La Lettre d’Aristée semble donc devoir être lue depuis le début comme une réponse à cette question et comme une entreprise de légitimation du transfert d’un texte révélé de l’hébreu au grec, du sacré au profane. De nombreux éléments narratifs vont dans ce sens.
La traduction est tout d’abord attribuée à une initiative royale, et il ne s’agit pas de n’importe quel roi mais de Ptolémée II Philadelphe, fondateur des institutions culturelles d’Alexandrie dont le prestige s’est maintenu bien après son règne . Avant même tout début de réalisation, le projet de traduire a fourni l’occasion de bienfaits envers la communauté juive locale car le roi – d’ailleurs à la demande d’Aristée – décide de racheter la libération des captifs de guerre ramenés de Judée par son père (§12-27) ; le décret royal est même intégralement reproduit !Selon la proposition de Démétrios, les traducteurs ne seront pas des Juifs d’Alexandrie (§22-25) mais des sages venus de Jérusalem, la Ville Sainte : “ On écrira au grand prêtre de Jérusalem d’envoyer des hommes des plus honorables, des Anciens compétents dans la science de leur Loi ” (§32).
Le grand prêtre réagit plus que favorablement à la demande royale. Non seulement il n’y voit rien de sacrilège, mais il la considère comme une preuve de piété (§42).
Les traducteurs choisis par une si haute autorité ne sauraient être qu’ éminemment fiables. Lors du banquet offert en leur honneur, ils prouvent publiquement leur exceptionnelle sagesse. C’est déjà un gage de la qualité de leur future traduction. La traduction se fait dans des conditions de pureté et de piété. Pas plus que pendant le banquet, les traducteurs n’auront à enfreindre leurs règles alimentaires lors de leur séjour à Alexandrie. Chaque jour, ils ne se mettent au travail qu’ après la prière non sans s’être au préalable “ lavé les mains dans la mer selon la coutume de tous les Juifs ”. Aristée, intrigué par cette coutume, en reçoit l’explication : le geste de se laver les mains marque symboliquement que celles-ci sont pures et qu’ ils n’ont commis aucune mauvaise action.
Dans le paisible quartier où ils travaillent, sur l’île de Pharos, “ magnifique séjour entouré de silence ” (§301), ils achèvent la traduction en soixante-douze jours, “ en se mettant d’accord entre eux sur chaque point par confrontation ”. La version grecque de la Bible est donc le résultat d’un travail d’équipe harmonieux, sans mystère. Une légère note de merveilleux est cependant introduite : le nombre de jours nécessité par la traduction est égal à celui des traducteurs ; cela suggère que “ pareille chose est due à quelque dessein prémédité ” (§307). Le Pseudo-Aristée hésite à dire clairement que la traduction a bénéficié de l’approbation divine mais c’est bien ce qu’il laisse entendre.
À l’approbation de Dieu succède immédiatement celle des hommes. L’admiration du roi a certes son prix, mais celle de la communauté juive réserve des conséquences incalculables. Des copies de la Torah grecque, le Pentateuque, vont désormais être déposées dans ces lieux où chaque septième jour on commente la Loi, les proseuques (du grec proseuchè “prière”), appelées aussi “synagogues”, dont l’existence commence à être attestée par des inscriptions dès le IIIème siècle . Pour l’instant, les chefs de communautés réclament copie de la traduction et s’engagent à la conserver sans aucune retouche, car elle a été faite “ correctement, avec piété et avec une exactitude rigoureuse ” (§310).
Cet engagement en dit long. Il signifie que les Juifs d’Alexandrie et de toute l’Egypte puis ceux de tout le monde hellénophone sont persuadés de posséder une traduction grecque si conforme à l’original qu’elle en reçoit une part de sacré. L’interdiction de retoucher la version grecque semble un écho de l’injonction deutéronomique : “ Vous n’ajouterez rien et ne retrancherez rien ” (Deut. IV, 2, XIII, 1).
L’unanime enthousiasme suscité par la version des Septante implique que l’on avait bel et bien le droit de traduire le texte sacré, mais tous les détails donnés sur les circonstances de la traduction visent à montrer que celle-ci était seule légitime, seule authentique et immuable.
Une traduction sacrée ?
Le léger élément de merveilleux introduit par le Pseudo-Aristée semble, on l’a vu, signifier que l’entreprise de traduction agréait à Celui-là même qui avait donné la Torah aux hommes. Un siècle ou deux plus tard, nous avons la preuve que cette traduction avait acquis un statut égal à celui du texte original.
Comment interpréter autrement ce fameux texte de Philon d’Alexandrie dans la Vie de Moïse (II, 37-40) où il affirme que les traducteurs :
“ prophétisèrent comme si Dieu avait pris possession de leur esprit, non pas chacun avec des mots différents, mais tous avec les mêmes mots et les mêmes tournures, chacun comme sous la dictée d’un invisible souffleur. ”
Les auteurs de la traduction étaient :
“ non pas des traducteurs mais des hiérophantes et des prophètes, eux à qui il a été accordé, grâce à la pureté de leur intelligence, d’aller du même pas que l’esprit le plus pur de tous, celui de Moïse. ”
Il y avait donc eu soixante-dix ou douze hommes qui, réunis pour accomplir une tâche sacrée, avaient ensemble reçu en quelque sorte une inspiration égale à celle de Moïse. Philon ne connaît plus leurs noms et ne s’intéresse guère aux circonstances de leur arrivée à Alexandrie. Ce qu’il croit bon de souligner, c’est que ,dans la retraite où ils s’établirent pour travailler, ils étaient en pleine communion avec la nature,
“ terre, eau, air, ciel, sur la genèse desquels ils s’apprêtaient à faire les hiérophantes – car la Loi commence par la création du monde. ”
“L’invisible souffleur” avait ainsi pu leur dicter un texte grec en tous points fidèle au texte hébreu (que Philon nomme “chaldéen”) :
“ Toutes les fois que des Chaldéens sachant le grec ou des Grecs sachant le chaldéen se trouvent devant les deux versions simultanément, la chaldéenne et sa traduction, ils les regardent avec admiration et respect comme deux sœurs, ou mieux, comme une seule et même œuvre, tant pour le fond que pour la forme. ”
Bien que Philon n’utilise pas le terme, une telle fidélité tient du miracle. Et c’est bien un miracle que célébraient de son temps ses coreligionnaires en se rendant chaque année sur le lieu-même où il s’était produit, dans l’île de Pharos :
“ C’est pourquoi, jusqu’à nos jours, une fête et une panégyrie sont célébrées chaque année dans l’île de Pharos, pour laquelle non seulement les Juifs, mais quantité d’autres personnes font la traversée, à la fois pour vénérer le lieu où cette traduction a jeté sa première clarté et pour rendre grâces à Dieu de cet antique bienfait toujours renaissant. Après les prières et les actions de grâces, les uns plantent leur tente au bord de la mer, les autres se couchent à même le sable de la plage, à la belle étoile, et ils festoient avec leurs parents et leurs amis, trouvant alors plus de somptuosité sur cette plage que dans de luxueux palais royaux. ”
(ibid. 41-42)
Ainsi, les Juifs d’Alexandrie auraient été les premiers à célébrer le don de la Torah – mais d’une Torah grecque. Leur fête devait se tenir à la belle saison si l’on en juge par la description de Philon. Elle n’était sans doute pas éloignée de la fête de Shavuot qui, par la suite, est devenue dans la tradition rabbinique zeman mattan toratenu “le temps du don de notre Torah”. À l’époque de Philon, Shavuot (Pentecôte) était encore une festivité agricole où l’on apportait les prémices de la récolte en offrande au Temple. Après 70, il fallut faire une révision douloureuse des fêtes de pèlerinage et c’est ainsi que la fête de Shavuot en est venue à commémorer la révélation du Sinaï. La fête alexandrine prouve que déjà une partie au moins de la diaspora hellénophone célébrait la traduction de la Septante comme une sorte de révélation.
L’idée que la Torah sous sa forme grecque était l’équivalent ou la sœur de la Torah du Sinaï n’avait pu se répandre qu’en milieu juif largement hellénisé. Cette propagande en faveur de la Septante ne trompait guère un Juif venu de Judée. Le petit-fils de Josué (Jésus) Ben Sira (ou Siracide), introduisant sa propre traduction grecque du livre de son grand-père vers –130, demande l’indulgence du lecteur dans son prologue.
“ Car elles n’ont pas la même force, les choses dites en hébreu dans ce livre, quand elles sont traduites dans une autre langue. D’ailleurs, non seulement ce volume mais la Loi elle-même, les Prophètes et les autres livres offrent aussi une différence considérable quant à leur contenu. ”
Il souligne donc au passage qu’il a constaté un certain écart entre l’original et la traduction des textes sacrés. Or Philon prétend le contraire lorsqu’il écrit :
“ Qui ne sait que toute langue – et particulièrement la grecque – est foisonnante en mots, et que la même pensée peut-être rendue de multiples manières en changeant les termes ou en employant des synonymes et en recherchant le mot propre dans chaque cas ? Ce qui n’eut pas lieu, à ce que l’on dit, à propos de notre code de lois, mais le mot propre chaldéen fut rendu exactement par le même mot propre grec, parfaitement adapté à la chose signifiée. De même, en effet, à mon sens, qu’en géométrie et en dialectique les choses à signifier ne supportent pas la bigarrure dans l’expression, qui reste inchangée une fois établie, de même aussi, semble-t-il, ces traducteurs découvrirent les expressions adaptées aux réalités à exprimer, les seules ou les plus capables de rendre avec une parfaite clarté les choses signifiées. ”
(Mos. II, 38-39)
Cette évidente contre-vérité ne saurait toutefois être reprochée à Philon. Il est le dépositaire d’une tradition alexandrine qui, au fil du temps, a développé l’idée que la version grecque était d’inspiration divine. De ce fait, la Septante devenait à son tour un texte sacré . On était donc autorisé à la commenter comme tel, ce à quoi Philon s’est employé avec ardeur.
En conséquence , il devenait légitime à Alexandrie de fonder une exégèse sur tel ou tel terme grec. Ainsi , Philon découvrant que la terre était “invisible” aoratos en Genèse 1.2 (là où l’hébreu a l’intraduisible tohu vavohu) , en conclut que le “jour un” est celui du monde intelligible. Seul le terme choisi par la traduction grecque pouvait l’orienter vers une telle interprétation platonicienne.
L’idée qu’une veritas Graeca pouvait se substituer à une veritas Hebraica devait avoir des conséquences incalculables avec l’apparition du christianisme. L’embellissement de la légende alexandrine se poursuivit dans la jeune Eglise chrétienne. On peut la suivre chez divers Pères de l’Eglise. Les soixante-dix traducteurs auraient été séparés les uns des autres et néanmoins leurs traductions respectives se seraient trouvées en parfait accord. N’était-ce pas là un effet de l’esprit saint ? Voilà comment la Septante sacralisée par les Juifs alexandrins est devenue l’Ancien Testament des Chrétiens.
Un coup d’arrêt au développement de la légende fut porté par Jérôme quand il revint au texte hébreu pour traduire la Vulgate, malgré les “aboiements” de ses critiques. Même lorsque la Vulgate fut déclarée seule “authentique” au concile de Trente, elle n’atteignit jamais le statut sacré qui avait été celui de la Septante en son temps.
Quand au judaïsme rabbinique, il ne se montra guère hostile à toute traduction en grec. Bien au contraire, la traduction d’Aquila reçut le patronage des plus hautes autorités du début du IIème siècle. Si la Septante fut écartée, c’est parce qu’elle était devenue le livre d’une religion dissidente, mais on convenait que la Bible ne saurait être traduite qu’ en grec . N’était-ce pas la meilleure façon de faire habiter ” Japhet dans les tentes de Sem” ? Mais seule la langue d’Eber, fils de Sem, pouvait mériter le titre de langue sacrée , leshon haqodesh.
Mireille Hadas-Lebel, Professeur à l’Université Paris IV – Sorbonne








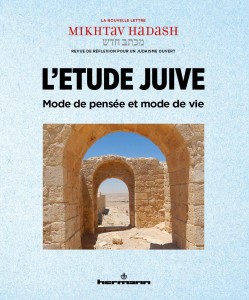


Messages
dictonnaire grec- latin
dictionnaire grec-allemand
car insurance quotes fl xry lipitor antibiotics 73819 state auto insurance xto
Voir en ligne : http://www.competitiveinsurancequot...