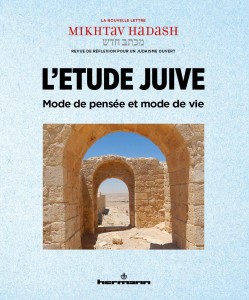Certaines choses s’oublient, d’autres sont inoubliables ; mais il semble que l’inoubliable finisse par s’oublier aussi. Mémoire et oubli semblent nécessaires à l’homme. Celui-ci tente de se survivre dans une mémoire plus qu’humaine, une civilisation qui ne meure pas ; aussi la civilisation est-elle liée à l’archive, plus généralement à l’écriture. Mais être archivé suppose une hiérarchie, un tri de ce qui vaut d’entrer dans les archives ; autorisation et interdiction, prise en compte et exclusion, sacrifice et accusation, défense et illustration. Ce qui est valorisé définit alors une surhumanité qui est comme une destination pour l’homme et sert ainsi de critère pour conserver ce qui vaut, ce qui ne doit pas être oublié. Le divin et la civilisation, tels sont deux aspects de l’inoubliable — car d’abord ils définissent ce qui ne doit pas être oublié. Il est essentiel pour chaque société humaine de définir ce rapport entre le fini et l’infini, entre le microcosme et le macrocosme. Les mythes sont en quelque sorte les récits qui nous racontent les moyens d’en finir avec l’infini, de donner à chaque chose sa place et de s’en souvenir.
L’homme est un être d’habitudes ; ce qui est acquis ne s’oublie pas. Pour acquérir de nouvelles habitudes, il faut cependant se séparer d’anciennes habitudes ; il faut vouloir oublier. L’ensemble de nos habitudes, nous pouvons l’appeler culture, civilisation. Il semblerait qu’oublier la civilisation soit pour l’homme une renonciation à son humanité ; mais en un autre sens, il semble aussi que l’humanité de l’homme suppose la faculté de renoncer à certaines habitudes pour en acquérir d’autres, meilleures. L’effort de civilisation serait donc un effort héroïque pour se libérer d’habitudes qui seraient d’anciennes marques de civilisation — comme un art qui saurait où tailler la tige pour que prospère le rameau. Les fables, les fictions nous racontent souvent des histoires dont les moralités sont des tentatives pour se défaire des mauvaises habitudes contractées par la civilisation même, pour réparer le désordre causé par l’ordre même — et lorsqu’on pense ne pas pouvoir échapper à cet ordre qui produit du désordre, on appelle cela le tragique.
Les générations de dieux se succèdent, les dieux du ciel succèdent aux dieux de la terre ; à l’interdit d’oublier telle loi divine succède l’obligation de l’oublier ; ce qui était béni devient maudit. Les nouvelles divinités succèdent aux anciennes et ce qui était inoubliable un jour finit par être oublié. Y a-t-il progrès de l’humanité dans cette succession d’oublis ? Ce que nous gagnons sur un plan, peut-être le perdons-nous sur un autre ; ce qui fut gagné finit par se perdre. Y a-t-il des choses qui ne se perdent ni ne s’oublient, du divin qui ne passe pas ? Peut-on échapper au tragique de la condition humaine ? La civilisation ne consiste-t-elle qu’à contracter de nouvelles mauvaises habitudes ? Nous nous confronterons à ces questions en parcourant le mythe d’Orphée encadré de quelques enseignements bibliques.
Il est une contrée bénie, une cité agraire, ville riche et paisible, bénéficiant de fortifications naturelles, de sous-sols aurifère et gemmeux ; où, déjà nanti, on peut encore s’enrichir, faire fructifier son bien ; nul besoin de se plaindre, nul besoin d’aide dans cette ville où ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi. Ville autarcique où l’on ne vient que si l’on est riche, pour jouir de ses richesses et mener une vie de jouissance ininterrompue.
Quatre hommes pourtant regardent en direction de cette cité maudite et deux vont s’y rendre. D’Hébron à Sodome, le chemin est court ; le plaidoyer d’Abraham et la miséricorde divine le rendent interminable ; les deux messagers raccourcissent leurs pas pour n’arriver qu’au soir, éloigner la sentence, repousser l’exécution. Ils viennent chercher le neveu d’Abraham. Mais Loth le quitte bien à regret ce pays de cocagne, et c’est seulement sa parenté avec Abraham qui lui permet de reconnaître les deux messagers divins et de saisir la gravité de la situation. Il se retarde, car il hésite dans le choix de ses possessions innombrables ; sans ses sauveurs, il oublierait vite que l’Eternel fait passer le temps, que Sodome ne sera plus.
Il sait se sauver, mais n’a pas su éduquer sa famille comme Abraham l’a éduqué lui-même. Il a la force de s’exiler et de se tourner vers l’avenir, mais ses filles reproduisent avec lui dans cet avenir les perversions de leur milieu : ivresse et inceste — à la fin du chapitre 18 de Bereshit, tsadiqim est orthographié sans le yod du pluriel, pour signifier que le titre de "juste" est tout relatif quand il s’agit d’un habitant de Sodome ; Loth n’a pas tout de suite la force morale de fuir jusque dans la montagne, de s’élever ; il fait étape dans une bourgade qui s’appellera Tsoar, analogue à mitsar, chose de peu ; par la suite, la montagne ne lui servira qu’à se mettre à l’écart, prétexte pour ses filles à l’inceste.
La femme de Loth part, forcée, mais incapable de refaire sa vie, de l’envisager ; l’envie de se retourner est trop forte car le désir est ambivalent. Sodome est inoubliable à deux titres : elle éprouve par son salut un sentiment de supériorité vis-à-vis des Sodomites, mais aussi un regret de la vie de Sodome. Malgré la nécessité de fuir et l’interdit divin de se retourner, elle regarde en arrière tiraillée dans ce sens par deux sentiments complémentaires, et reste ainsi figée. Fuir et survivre ou jouir et mourir. Son retournement manifeste une impatience, car la fuite est ici commandement divin et non désirée ; citoyenne de Sodome, elle abhorre l’indigence, le dénuement ; son salut perpétue son sentiment d’autosatisfaction, de supériorité, de perfection. Abandonner ses biens demande d’oublier momentanément son confort pour reconquérir plus tard une autre stabilité. Quel effort héroïque que d’interrompre une jouissance ! Si on trouve la force de s’arracher à un lieu, quelle nostalgie du pays perdu ! Ce pays nous était hospitalier s’il ne l’était pas à d’autres. Quel plaisir de vivre entre gens biens, entre nous, dans un lieu protégé d’où tout importun est écarté !
Les habitants de Sodome sont ses modèles et ses rivaux ; ses rivaux parce que ses modèles. Elle se conduit toujours selon la loi de Sodome, toujours à regarder vers soi, en arrière vers l’autarcie, la jouissance, la possession de soi et jamais vers l’autre, vers l’avenir. Cette possession monolithique de soi dans la jouissance, c’est la statue et c’est le sel. La transformation en statue de sel est aussi la punition ironique de l’Eternel pour qui veut accéder à l’immortalité, à une forme d’éternité par les œuvres de la civilisation ; on peut interpréter cela comme une ironie à l’égard de préoccupations égyptiennes. La mort, la punition de la mort manifeste le soupçon que derrière la surface des choses, il y a un sens qui nous échappe. On peut réagir à cela en formant une cité autarcique, où l’activité incessante, le temps contraint remplit tout l’espace humain — la jouissance individuelle où il n’est pas de don produit censément une sexualité perverse ; ici ce n’est pas une préférence homosexuelle qui est visée, mais la négation de l’altérité. Si la femme de Loth se retourne, ce n’est certes pas dans un geste de compassion pour ses concitoyens ; elle s’immortalise avec Sodome dans ce geste tragique qui enfreint l’interdit divin et marque son appartenance statufiée à la cité maudite. La punition divine, comme dans d’autres occurrences, condamne la croyance humaine dans la possession, la jouissance du Bien à l’exclusion d’autres humains.
Ce geste, le regard en arrière, convoque immédiatement pour nous un autre retournement mythique, un autre épisode tragique : l’histoire d’Orphée et d’Eurydice. Orphée charme Hadès qui l’autorise à repartir avec son épouse pour la ramener dans le monde des vivants ; seule condition, il ne doit se retourner avant d’être sorti des Enfers sous peine de la perdre pour toujours. Il guidera Eurydice au son de sa lyre. Ici, évidemment pour nous, c’est Orphée qui est responsable directement de la perte d’Eurydice, alors que Loth n’a qu’une responsabilité indirecte, et encore discutable. Eurydice n’enfreint pas d’interdit divin, elle semble victime dans toute l’histoire — dans la version tardive du mythe ; car dans l’ancienne, Eurydice serait Agriopé, la déesse-Serpent du Tartare dont les victimes meurent d’une morsure ; tous deux sont de toute façon des personnages funèbres ; l’orphisme étant en outre lié à l’égyptianisme. Ces personnages de l’Hadès évoquent le rapport de toute civilisation à ses morts, morts qui vivent encore par les œuvres de civilisation, avec qui on entre en compétition si on veut œuvrer dans le monde. Il faut remonter vers eux et aussi s’en défaire, les chanter et couper court à leur présence trop insistante parmi nous — continuité et discontinuité qui font le temps et notre conscience.
Ce retournement orphique immortalise le poète-musicien plus que tout autre passage de ce mythe. Orphée est le symbole du poète traditionnel choyé par les Muses qui suit les interdits, les règles, joue avec elles, charme les hommes, les bêtes, les rochers, les monstres, les dieux ; œuvre de communication universelle, œuvre messagère, hermétique, inspirée — opaque pour les successeurs rien qu’humains d’Orphée qui semble capable de remonter jusqu’au bruit de fond inarticulé de l’univers. Mais il est aussi artiste moderne : car la première œuvre "moderne" passe souvent inaperçue, c’est la perte d’Eurydice, l’oubli de l’interdit qui fait œuvre géniale ; tous les chefs d’œuvre répètent en un sens l’insouciance tragique d’Orphée.
Voir la lumière du jour alors qu’on est encore dans les Enfers, anticiper la sortie, le pouvoir diurne, et se retourner pour voir non une image, non un stéréotype, mais Eurydice, dans sa singularité éternelle, ni morte, ni vivante, chef d’œuvre du regard à la fois trop soucieux et insouciant d’Orphée qui l’immortalise ; lui perd sa possession amoureuse, mais il les immortalise tous deux comme symboles de la passion amoureuse ; ainsi naît le mythe du poète et la compétition ancienne et moderne pour rivaliser avec Orphée.
La série des pas menait Orphée toujours un peu plus loin de la possession d’Eurydice, paradoxe de Zénon ; Enfers interminables, Eurydice inoubliable — Orphée soucieux se demande si Eurydice parvient bien à le suivre, et en cela, déjà, il interrompt son chant qui rythmait l’interminable sortie, la rendant ainsi interminable. Soudain, la lumière du jour au bout du tunnel ; soudain, le terme du périple et l’anticipation d’une possession sans terme ; soudain, le regard d’Orphée brise l’interdit, perd l’Eurydice quotidienne mais conserve à jamais pour les générations l’œuvre nommée Eurydice, le chef d’œuvre nommé Orphée et Eurydice. Regardons nous aussi en arrière pour y voir de plus près et percer les ténèbres de ce mythe — la prêtrise orphique relie Dionysos et Apollon, le royaume de Terre, de la religion archaïque à l’Olympe, aux dieux du ciel, à la nouvelle religion des cités.
Nous devons comprendre pourquoi oublier l’interdit divin est impliqué dans l’obéissance à l’interdit divin, et pourquoi cela définit la civilisation, la culture — l’œuvre d’art, la technique relèvent d’une désobéissance aux dieux, sur fond d’oubli, comme dans le mythe de Prométhée. Nous avons là une division du vouloir : un vouloir obéissant ou plutôt qui devrait obéir et une volonté de vouloir, de se commander à soi-même. Il y a donc d’une part :
– un vouloir relatif, un vouloir relatif à un objet (un désir)=vouloir oublier l’interdit de se retourner=voir Eurydice (mais la perdre)
– un vouloir absolu (commandement/obéissance)=vouloir vouloir l’interdit de se retourner=ne pas voir Eurydice (mais la gagner)
Il y a -impossibilité d’oublier Eurydice=désir de voir Eurydice
et -impossibilité d’oublier l’interdit car il est lié au désir de voir Eurydice
mais l’interdit en lui-même peut être oublié car il est en contradiction avec le désir de voir Eurydice (désir=immédiateté, interdit=médiateté)
Il faut donc -vouloir oublier momentanément Eurydice pour la gagner,
mais on peut -vouloir oublier momentanément l’interdit pour voir Eurydice.
L’interdit divin ou Eurydice, c’est la même opération de vouloir oublier momentanément ; sauf qu’Eurydice est, contrairement à l’interdit divin, l’objet d’un vif désir. C’est ce caractère interchangeable de l’oubli qui est le fonds du tragique ; fauter c’est toujours se tromper, manquer sa cible : Platon nous dit « Nul n’est méchant volontairement. » Obéir aux dieux et oublier les interdits divins, désobéir ne sont que les deux revers du destin dans un monde où les dieux sont immanents et où les buts désirables s’imposent à l’homme ; obéir ou désobéir sont des accomplissements du destin ; obéir, c’est oublier qu’on obéit, car la conscience paralyse l’obéissance ; mais lorsqu’on obéit en oubliant qu’on obéit, on est tout près d’oublier d’obéir, et donc de désobéir. Mais aucune civilisation ne serait possible si on ne désobéissait tout autant qu’on obéit ; l’homme est un loup pour l’homme, il doit donc obéir ; mais l’homme est aussi un dieu pour l’homme, il doit désobéir. En dehors du monothéisme, on pourrait dire que seule l’immortalité des œuvres de la civilisation rend supportable la mort ; elle produit l’éternité ou une image de l’éternité dans le temps. Obéir ou désobéir aux dieux est équivalent et fonde la compréhension d’un destin implacable, d’un ordre du monde qui donne crédibilité à nos vies, à nos œuvres, à nos civilisations.
C’est en ce point que se marque, autour des mêmes problèmes, la différence complète avec le monothéisme et sa conception de la responsabilité humaine. Les problèmes de l’obéissance, du commandement divin, de l’œuvre humaine se retrouvent de façon saillante et centrale dans les récits bibliques et le traité talmudique consacré au shabbat. Terre et ciel furent terminés, le tout étant considéré comme très bien ; Dieu y mit fin à shabbat ; il se reposa shabbat ; il bénit le shabbat ; il le proclama saint, en raison du repos shabbatique de tout ce à quoi il avait mis fin.
On sent chez le créateur la volonté infinie, la volonté de vouloir, l’effort persévérant pour ne pas se retourner vers l’œuvre de création et faire cessation, sécession, séparation avec son œuvre — Dieu n’est pas le modèle de sa création avec laquelle il pourrait rivaliser. Le Dieu de la Bible bien loin de remplir le monde ajoute un vide, un surcroît et se pose comme le Dieu qui n’existe pas, qui n’est pas crédible. Au sixième jour, on se retourne vers le créé et on se convainc que tout est bien, très bien, même si du mal résultera de la création de l’homme — on pourrait avoir une préformation, une providence divine, si on en restait à la fin du sixième jour où tout se termine, le monde et tout ce qu’il renferme : on aurait alors le destin ; convenance du désir de Dieu et de sa volonté ; harmonie préétablie du Dieu leibnicien, adéquation de l’entendement et de la volonté divine — le bien, c’est la séparation qui unit ; le mal, c’est la rivalité, la totalisation qui divise.
Mais il y a un septième jour, où Dieu s’y reprend à quatre fois, au moins, pour se séparer de son œuvre, pour "devenir" transcendant — séparation qui commandera une révélation. Il met fin au point final non en rajoutant un point final mais en s’en séparant. Tout se présente dans le texte de la Genèse comme si Dieu faisait un effort transcendant pour se reposer ; Dieu ainsi laisse place à son co-créateur l’homme. Dieu suite à la création ne se laisse pas aller au repos, mais au contraire, en se reposant volontairement, il laisse aller la création.
Le passage suivant récite la deuxième formation de l’homme — qui est la reprise du mythe babylonien dit du « super-sage », reprise qui en transforme en profondeur le sens, ne serait-ce que par son positionnement après un texte plus récent qui définit la place de l’homme en surcroît et non comme rouage du cosmos, pourvoyeur de la nourriture des dieux. L’homme est un surcroît, une nouveauté, une série d’engendrements et Montaigne a raison de dire « les autres forment l’homme, moi, je le récite » ; car le texte biblique récite deux fois la formation de l’homme : d’abord, un être créé qui fait partie du monde, du projet divin (après bereshit bara elohim), puis un être créateur qui fait partie du shabbat divin (après bara elohim laassot). L’homme co-créateur doit aussi faire shabbat ; l’œuvre humaine accomplie doit laisser place à autre chose qu’elle-même ; il n’y a pas d’accomplissement humain, pas de destin à aimer.
L’obéissance à l’interdit shabbatique est donc une obéissance très particulière. Pas d’ordre divin, pas d’ordre naturel où l’obéissance permettrait de s’inscrire. Obéir à shabbat est obéir au vide matriciel qui découle du retrait divin. Le commandement du shabbat clôt l’ensemble des prescriptions relatives au sanctuaire dans l’Exode (XXV-XXXI, terouma, tetsave, ki tissa). Le point culminant de l’élévation de l’homme semble bien être shabbatique et couronner tout service divin — et dépasser même tout rapprochement par les sacrifices.
Le traité talmudique consacré au shabbat rend compte en des termes il est vrai assez abscons de cette particularité, qu’il faut pourtant comprendre si on veut saisir quelque chose du judaïsme. Si nous reprenons un instant la terminologie employée pour décrire le mythe d’Orphée, nous avons un vouloir relatif qui est le désir de reprendre nos travaux de la semaine, de transgresser shabbat, et un vouloir absolu qui est de vouloir l’interdit shabbatique, de faire shabbat, acte héroïque s’il en est.
D’une part, on veut oublier l’interdit de transgression soit retourner à la civilisation (mais la perdre),
d’autre part, on veut -l’interdit de transgresser=ne pas retourner à la civilisation (mais la gagner)
Il y a -impossibilité d’oublier la civilisation, son temps=désir de la création, des 40-1 travaux (désir du temple)
et -impossibilité d’oublier l’interdit du shabbat, car il est lié au maassé véreshit, au désir de servir Dieu, de co-créer.
Il faut -oublier momentanément la civilisation, même le désir du service divin dans la construction du temple ou le souci éthique des autres,
mais on peut aussi -oublier momentanément l’interdit shabbatique et se tourner vers les nécessités d’une vie civilisée.
L’obéissance à shabbat équivaudrait alors à l’oubli de l’essence de shabbat ; ils ne sont d’ailleurs séparés dans le talmud que par un sacrifice au temple. Vouloir obéir et vouloir oublier sont le vouloir de choses impossibles ; mais aussi en un sens, il est impossible d’être juif et d’oublier shabbat. Vouloir shabbat, vouloir obéir à shabbat divise le vouloir en deux forces, une force qui commande l’interdiction des 39 travaux et de leurs toldot, et une force qui refuse, qui s’inquiète de cette malédiction, de cet état maladif, de cet état de nature du shabbat, la force inoubliable de la civilisation, de nos projets, de nos désirs.
Vouloir shabbat est séparé de l’orphisme par un sacrifice au temple, car la loi de la vie n’est pas la loi de l’oubli, mais la vie naît du vide du shabbat ; le retrait d’Eurydice crée un vide qu’Orphée comble par son regard qui retire définitivement Eurydice, ironie du destin tragique. Le vide du shabbat est certes une forme d’oubli, ou plutôt, comme le suggère la Guemara commentant Rav et Shmuel, l’ignorance du shabbat est une forme d’oubli — le vide du shabbat peut être compris comme une réminiscence à effectuer ; nous sommes humains de par le shabbat divin ; le shabbat serait inscrit en chacun de nous.
Le shabbat n’est pourtant pas le symbole qui remembre le monde ; le shabbat est alliance qui se brise (karat brit), c’est-à-dire qui n’est que par le souvenir. Obéir ici n’est pas oublier mais se souvenir, se souvenir ici n’est pas désirer l’inoubliable Eurydice, mais se souvenir du vide matriciel de l’alliance, de la création, du shabbat. Le Talmud est explicite dans ses commentaires et pose un grand principe (et il y en a peu) : il est interdit d’oublier l’interdiction shabbatique. La loi est la loi du souvenir de l’alliance ; le retrait n’est pas perdition, perte de l’aimée, mais vide, accueil de la fiancée shabbat (lekha dodi).
Obéir, c’est cesser de vouloir de son propre chef, c’est oublier qu’on obéit pour se consacrer au commandement ; en obéissant, on est donc tout près d’oublier d’obéir et donc de désobéir. Obéir à shabbat, c’est presque oublier le principe de shabbat, qui est aussi de se commander à soi-même le shabbat ; le "presque" demande un sacrifice au temple qui n’existe plus, demande faite dans un droit par principe inapplicable. On me dit oralement clairement, même si l’écriture paraît très contournée (à cause de cette façon virtuose de rendre l’oral, de maintenir l’oralité dans l’écrit), que, dans le souvenir du shabbat, mon vouloir se divise en vouloir obéissant et volonté qui veut, en une force qui est dominée et une force qui est obéie ; la force qui commande est une déprise, une décivilisation, une surhumanité, une jouissance, une auto-limitation, un laisser-aller.
Quand j’obéis à shabbat sur le mode de l’oubli, de l’obéissance "aveugle", je suis passible d’un sacrifice au temple. Le converti (guer) de la Guemara de Rav et Shmuel est le cas pur de l’obéissance : il ne sait pas que shabbat existe, mais il a été converti par un (calamiteux ?) beit din. Le guer obéit au judaïsme mais son obéissance est vide de sens, il ne se souvient pas de shabbat. Faire shabbat, c’est se souvenir de l’alliance, c’est se souvenir d’obéir — Rav et Shmuel ne comprennent pas qu’on puisse oublier shabbat, mais pas au sens où shabbat devient une habitude inoubliable, l’alliance ne vaut que par le souvenir, dor vador.
"Grande règle générale de la mishna : celui qui a oublié le principe de shabbat..." : la grande règle est de se souvenir de shabbat ; j’obéis parce qu’une règle plus grande que moi me commande ; dans le souvenir du shabbat se fait la hiérarchie dans ma volonté — mais jamais cette hiérarchie n’est une totalité : très explicitement, ce sont « quarante moins un travaux » qui sont interdits par la mishna et non trente-neuf. Le texte qui me commande la grande règle se commente en hiérarchisant les principes (shabbat, shmita , maasser, peah), mais cette hiérachie fait l’objet d’avis contradictoires.
La hiérarchie dans le texte fait la hiérachie dans ma volonté qui fait que l’obéissance trouve son commandement dans une transcendance de la volonté à elle-même qui se nomme souvenir de l’alliance, commandement de l’étude (le maître des songes, celui qui recueille l’enseignement d’Israël, le premier à se souvenir est l’augment qui jaillit du retrait, Yossef). Pas de hiérarchie naturelle, pas même de hiérarchie divine, la hiérarchie se pose dans le commentaire talmudique qui s’entre-commente (mishna , guemara), texte talmudique qui vaut pour lui-même, sans quasiment de référence à la Torah.
« La loi qui interdit à » un juif de retourner vers la semaine, vers les trente-neuf travaux de la civilisation manifeste « une tension à l’intérieur même de la volonté, un écartèlement entre la « volonté-désirante » de se tourner vers l’inévitable, vers l’impossible objet de l’oubli qu’est l’habitude pour l’homme civilisé, et une « volonté-contraignante », une contre-volonté qui veut la loi, la loi de l’oubli [du monde plein, la loi du souvenir de l’alliance, la loi de l’obéissance], la loi de la vie ["et vous choisirez dans la vie"], entre une volonté portée vers un objet et une volonté qui se veut elle-même. [Le vouloir se souvenir, qui est l’oubli du monde plein, le vouloir obéir] apparaît ici comme une nature double : il y a un dédoublement entre la volonté d’obéir et une volonté de vouloir, entre deux termes, l’un relatif, l’autre absolu.
Et si un Juif doit un sacrifice au temple, c’est qu’il est coupable d’impatience. Son erreur est de vouloir épuiser l’infini, de mettre un terme à l’interminable qu’est l’impossibilité d’oublier la civilisation, de ne pas soutenir sans fin le mouvement de son erreur. L’impatience de celui qui veut oublier, c’est la faute de qui veut se soustraire à l’absence de temps ; la patience est la ruse qui cherche à maîtriser cette absence de temps en faisant d’elle un autre temps, autrement mesuré. En se soustrayant à shabbat, on se soustrait à l’absence de civilisation, de projet, de temps ; on ne soutient pas sans fin la soustraction au temps mondain qu’est shabbat, qui fait de l’absence de temps un autre temps, un temps en ajout.
Le temporel pour Platon est réalisation au sein de l’éternel, « organisaction », produit de l’auto-organisation du tout — « image mobile de l’immobile éternité ». Le temporel comme résultat de la création est ajout d’un surcroît par retrait de l’éternel, temps du monde en disparition, à la fois achevé et inachevé par le shabbat, absence de temps qui reçoit une mesure, le shabbat, non pas comme semaine où chaque jour est nommé, mais comme surcroît, sanctification.
A l’opposé d’une obéissance qui doit oublier que l’on veut obéir, d’une conscience qui paralyse le vouloir, l’obéissance à shabbat requiert l’interdiction d’oublier l’interdit, consciente que l’obéissance aveugle équivaut à l’oubli de shabbat. Quand, pendant shabbat, je m’efforce d’oublier la civilisation, mais que je me retourne vers elle, j’enfreins shabbat dans un instant d’insouciance. Mais oublier la civilisation n’est pas ce que demande shabbat ; la femme de Loth qui se retourne vers la cité en perdition se perd elle-même, se statufie. Le shabbat demande qu’on suspende les trente-neuf (quarante moins un) travaux, pour revenir ensuite vers la semaine et ainsi de suite. Le shabbat est ce qui suspend, nie la civilisation, mais qui lui donne sens et l’autorise ; avec shabbat, nous nous fiançons ; dans le shabbat, nous adoptons l’humanité.
Laurent Pietra : professeur de philosophie (Nice -Lycée Masséna), doctorant en philosophie à l’université de Paris X-Nanterre, collabore à la revue Médecine et Culture (de Ruth et Elie Attias, Cercle d’étude J-P Lévy à Toulouse -articles accessibles en ligne).
Membre de la Communauté Massorti de Nice